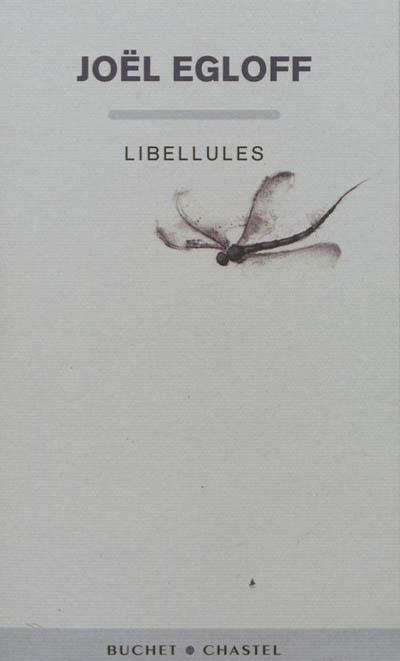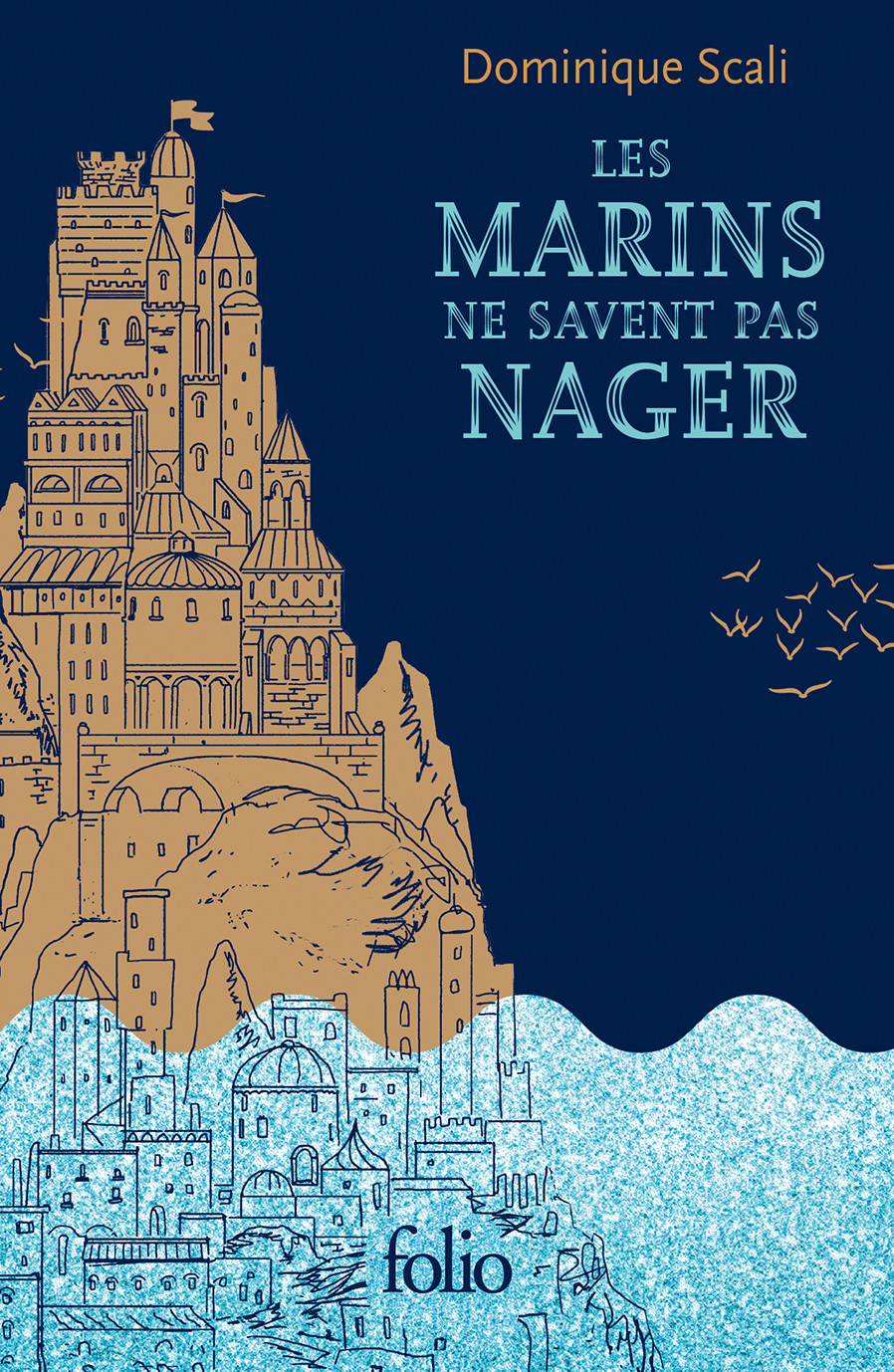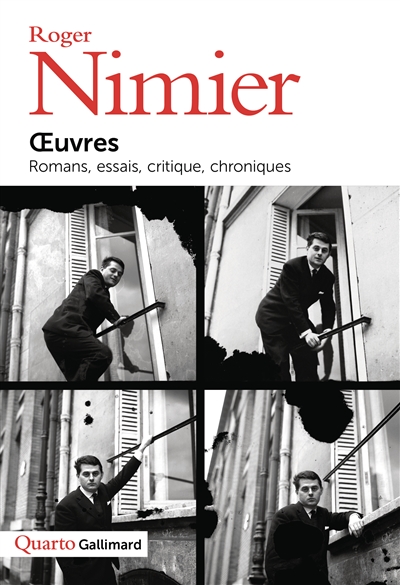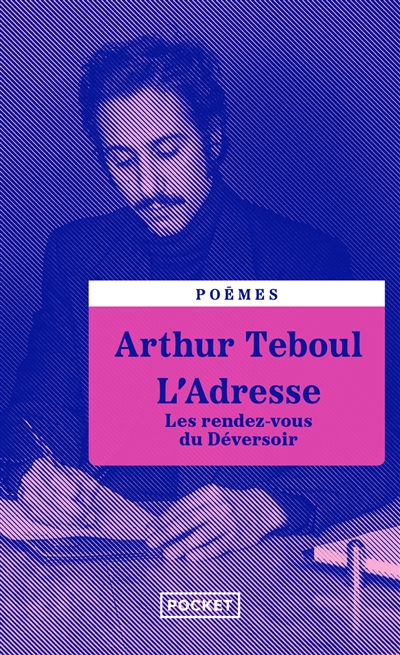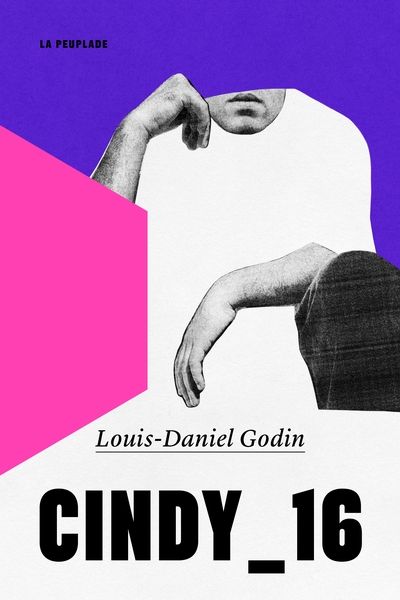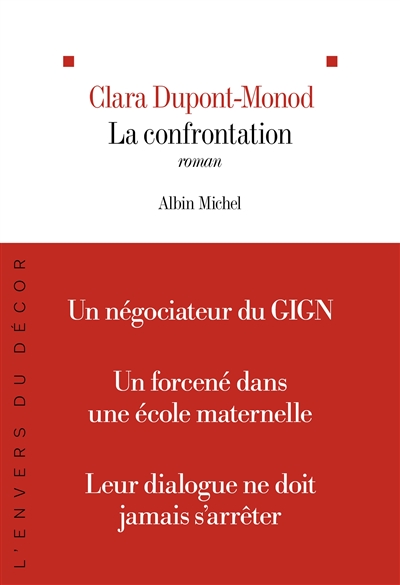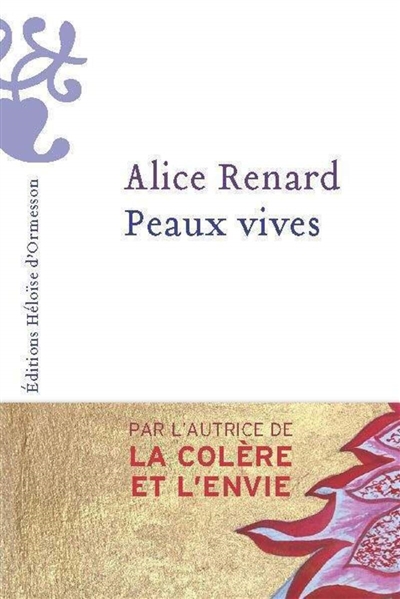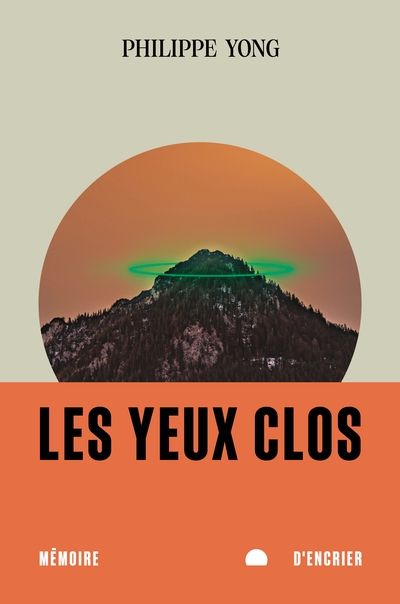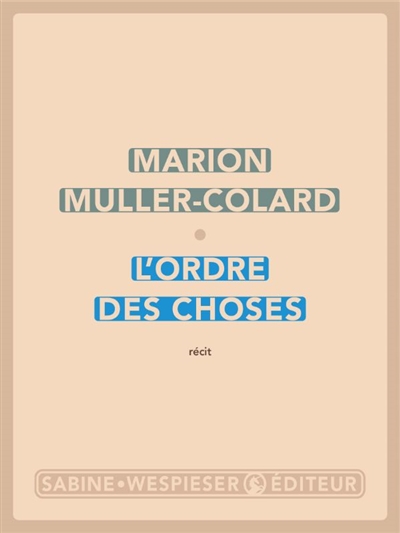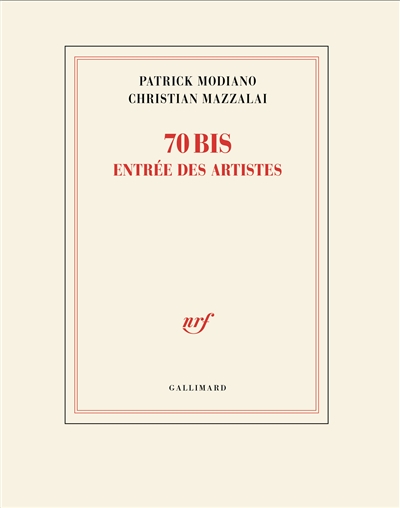Des scènes tirées du quotidien, presque anecdotiques, et c’est le monde et les mondes du narrateur qui se déploient. Pourquoi avoir choisi cette forme courte ?
Joël Egloff — Je ne sais pas vraiment comment définir ces textes, ce format. Je ne me suis pas posé la question. Cela ne changeait rien d’essentiel à mon travail. Ces formes courtes me permettaient surtout de m’affranchir le plus possible d’une histoire pour me focaliser sur une situation, un personnage, une rêverie. Un peu comme pour un peintre. Quel que soit le format de son tableau, même si les difficultés rencontrées ou les techniques employées sont un peu différentes, au bout du compte, c’est toujours de la peinture, c’est toujours un tableau. Ce qui diffère, c’est peut-être qu’à travers une petite fenêtre, on ne voit pas le même paysage qu’à travers une baie vitrée. On aperçoit certains détails qui nous auraient peut-être échappés avec une vision panoramique.
Comment en avez-vous dessiné la construction, comment avez-vous imaginé l’histoire de ce petit garçon qui revient comme un motif ?
J. E. — L’écriture s’est étalée sur un an et demi, environ, mais avec quelques périodes d’interruption. Même si les textes se suivent en respectant la chronologie de l’histoire, j’ai procédé à une sorte de montage pour donner un certain rythme à l’ensemble, avec une alternance de textes longs, de textes courts, des respirations et des ponctuations. Avant de me mettre à l’écriture, j’avais pris quelques notes, établi, au fur et à mesure, une liste de « petites histoires » que j’avais l’intention de développer. Toutes avaient quelque chose en commun dans l’esprit, et par le fait que le narrateur, le personnage de l’auteur, en était soit l’un des acteurs, soit l’observateur. Dans plusieurs de ces textes apparaissait le petit garçon et ses questions insolubles sur la mort. Assez naturellement, il s’est imposé comme l’un des leitmotivs du livre. Quant au personnage du père, bien sûr, il ne pouvait pas être « donneur de leçons »… Qui pourrait avoir la prétention de donner des leçons sur ce sujet ? Au contraire, même s’il tente de faire bonne figure, on le sent on ne peut plus démuni face aux interrogations de l’enfant, à ses inquiétudes.
Il est beaucoup question de regards, de points de vue, de reflets, de jeux de miroirs, de la position du narrateur dans la vie quotidienne, dans ses rêves, son enfance… Qu’avez-vous voulu écrire sur le monde ?
J. E. — La question du regard est importante, c’est vrai. Mon objectif était peut-être le même que celui d’un photographe qui tente de saisir ce qui justement échappe au regard, l’imperceptible détail qui va laisser transparaître la vérité d’un être ou d’un moment. Ce que j’ai voulu faire d’abord, c’est essayer d’être juste (au sens presque musical du terme), d’être au plus près de mon ressenti et des sentiments qui ont pu me traverser dans les situations que j’ai voulu décrire. C’est ce qui a guidé mon travail. Quant au monde, je ne sais pas s’il est bien ou mal fait. Il est tel qu’il est, nous sommes bien obligés de nous en accommoder. Cependant, il est aussi ce que nous en faisons. Il est tel que nous voulons bien le voir. Cette histoire d’oiseau qui s’envole alors qu’il semblait mort, c’est peut-être une réponse finale aux angoisses de l’enfant qui traversent le livre. C’est à la fois grâce à lui qu’il y a de l’optimisme, et pour lui qu’il doit y en avoir. C’est presque une obligation, un devoir d’optimisme envers l’enfant. Cette histoire de boîte aux lettres sans fond – dont le narrateur essaie d’extirper une lettre par tous les moyens – relève du reportage. J’ai essayé d’être le plus précis possible, car cela peut paraître surprenant, mais à peu de choses près, cette « opération de sauvetage » s’est déroulée précisément comme je l’ai décrite. Ce texte est pour moi assez emblématique de l’énergie démesurée que nous pouvons consacrer à certaines choses de notre quotidien, il parle de nos petits combats, de nos petites victoires de chaque jour, souvent dérisoires, mais aussi de nos grands espoirs, de nos idéaux, à travers cette lettre que le narrateur attend, sans même savoir de qui il l’attend, ni pourquoi.
Ces 24 nouvelles pourraient composer les 24 heures de la vie de Monsieur tout le monde. La dernière est, peut-être, la 25e heure de l’écrivain ?
J. E. — Le travail de l’écriture, forcément, impose de prendre son temps. C’est un exercice de longue haleine, un travail de fourmi, de fourmi solitaire. C’est laisser remonter des choses à la surface, c’est prendre le temps de chercher le mot juste, de construire sa phrase, de les organiser les unes par rapport aux autres. Et prendre son temps, c’est forcément accepter le risque de le perdre, également, accepter les heures stériles, l’immobilité, se répéter sans cesse : « À quoi bon ? » et pourtant y retourner. La question du temps qui passe et de ce que nous en faisons est très présente dans le livre, effectivement. Elle est bien sûr liée à l’idée de la mort, mais aussi à cet enfant qui grandit et découvre la vie. Que faire de ce temps infiniment précieux ? Comment ne pas rester pétrifié devant ce sablier qui sans interruption s’écoule ? Comment avoir le sentiment d’avoir vécu ? Ce sont ces questions qui apparaissent en filigrane des histoires. Le temps de l’écriture ou « la 25e heure de l’écrivain », pour reprendre vos propos, c’est peut-être celle qui tente en vain de fixer le temps.