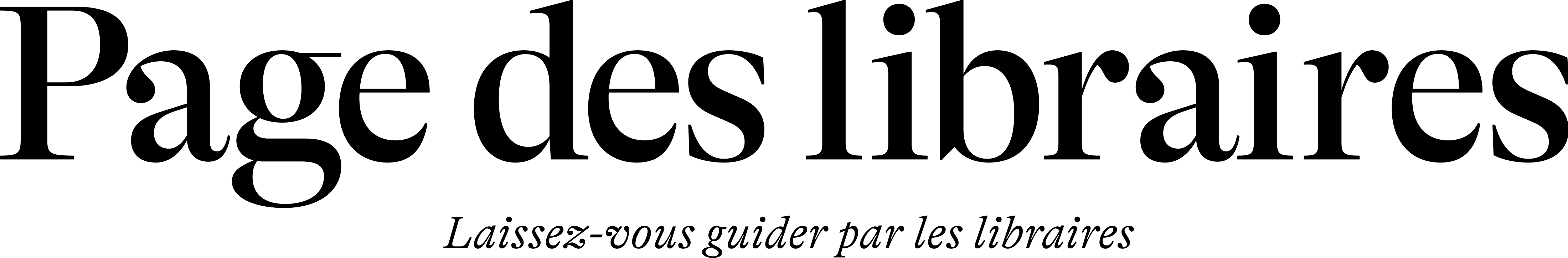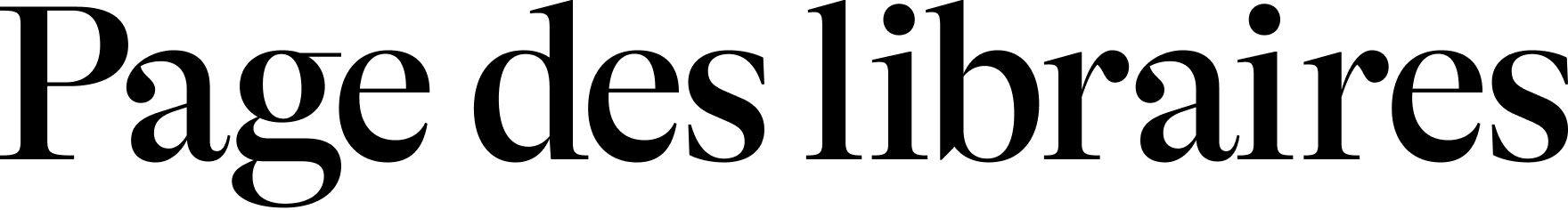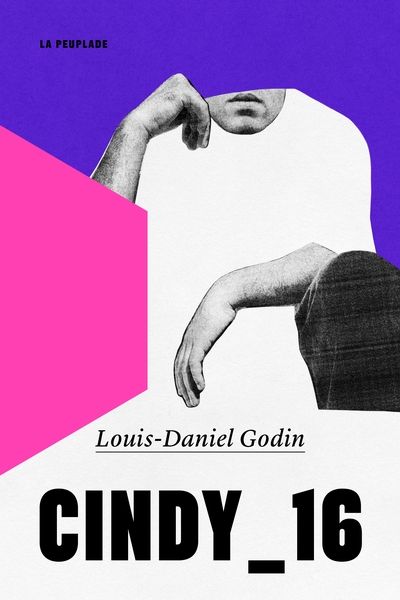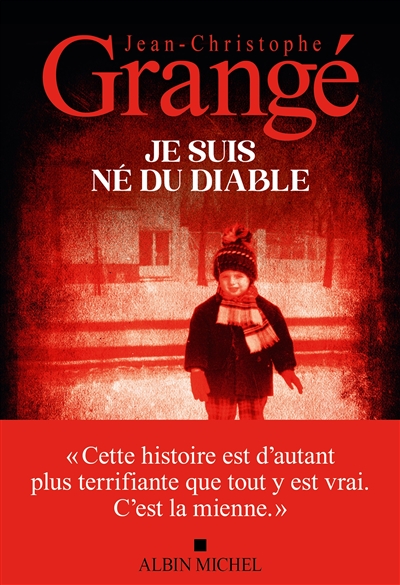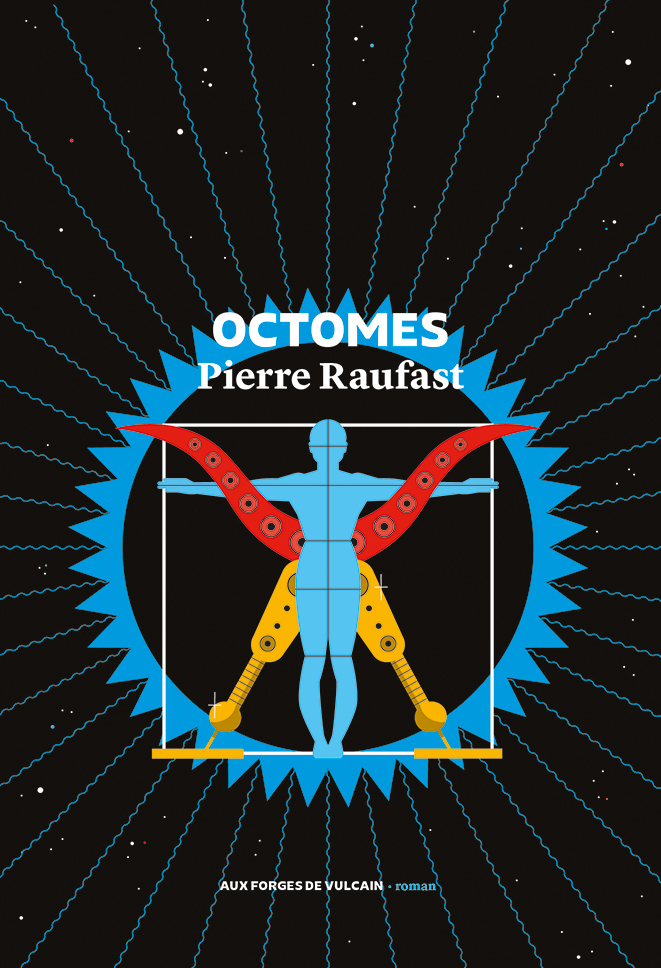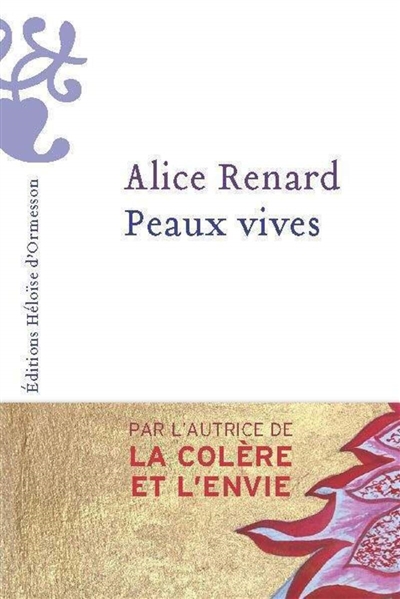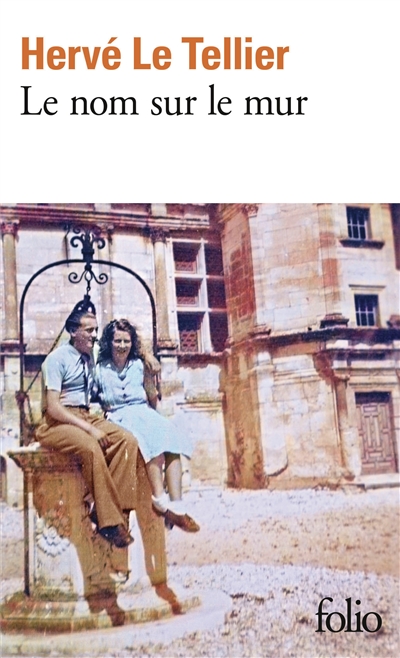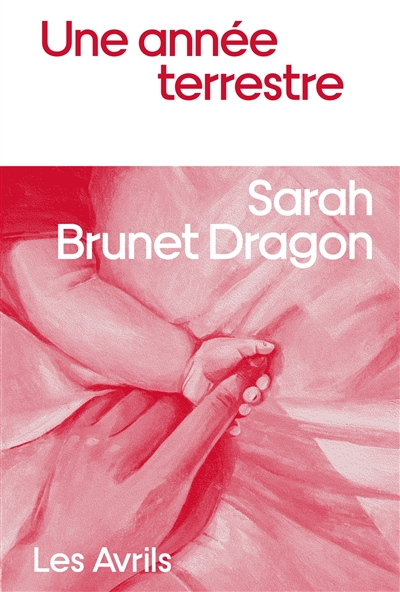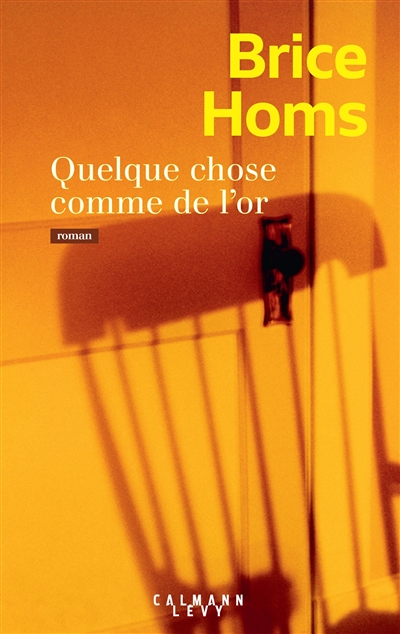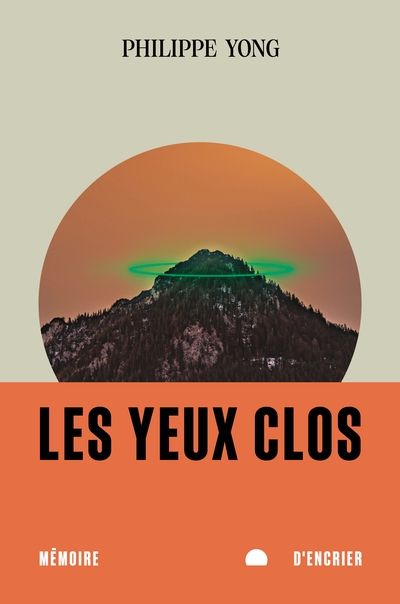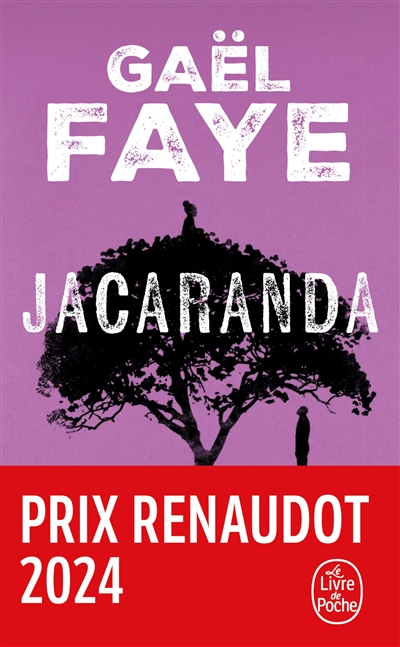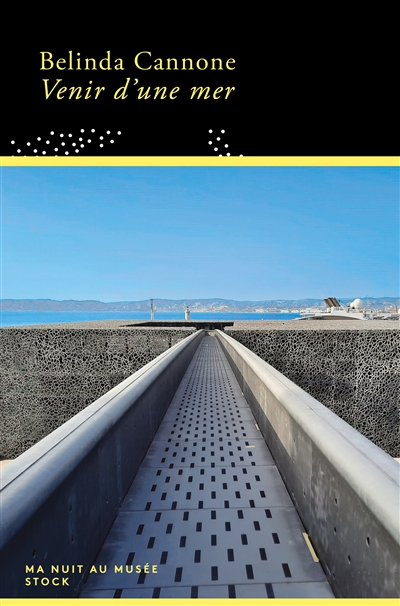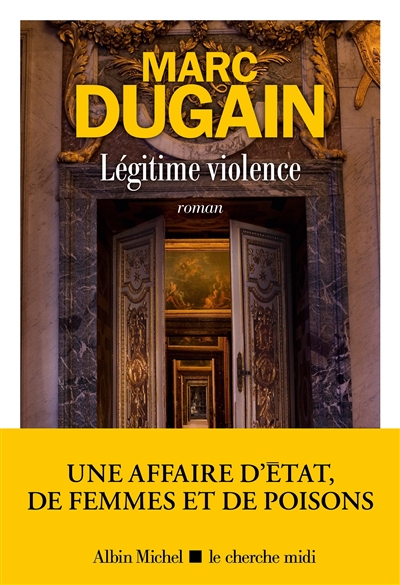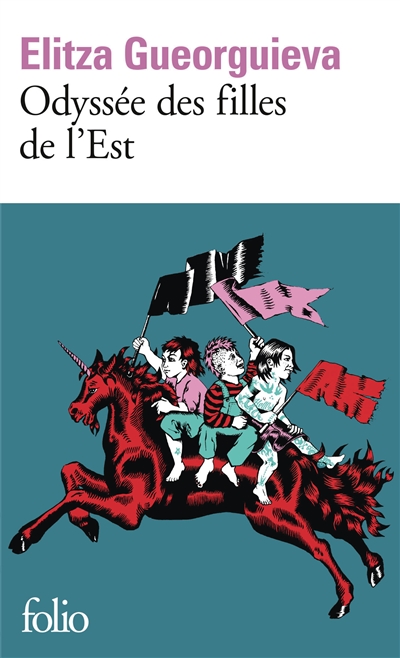En incipit de votre première partie, vous citez Jean Casimir : « son arme demeure sa complaisance feinte et son silence ambigu ». Pour vous, le silence peut-il être une arme ?
Yanick Lahens Je cite Jean Casimir qui est un ami, sociologue et grand connaisseur de l’Histoire. Il m’a beaucoup ouvert les yeux sur les armes usuelles des dominés esclavagisés pour tenir et construire un chemin au cœur de l’adversité. Le silence est l’une de ces armes puissantes. Mais il y a le rôle majeur des femmes dans l’utilisation de ce silence. Doublement dominées, par leur condition sociale et par leur genre, depuis les plantations, elles ont construit un pouvoir dans cette configuration esclavagiste. Par rapport au maître ou à la maîtresse de la plantation et dans leur communauté. En effet, la figure stable dans la communauté des esclaves était toujours celle d’une femme (mère, tante ou grand-mère). Dans l’espace rural de la contre-plantation après l’indépendance, la femme a été, et elle l’est toujours, le relais entre ce milieu rural et les bourgs et villes, puisque c’est elle qui majoritairement vend dans les marchés. Elle a donc construit le marché économique intérieur. Le paradoxe, c’est que les lois économiques et sociales formelles, occidentalisées, ne prennent pas en compte ce poids économique, social et féminin qui est pourtant énorme. La femme des milieux populaires majoritaires a donc construit sa puissance en dehors de ce qui officiellement la définit et la marginalise et ne s’est jamais résolue à être cette victime. Dans sa marginalisation, elle a construit un pouvoir. C’est un féminisme ancré dans une réalité historique particulière et dont il faut tenir compte dans toute réflexion sérieuse pour l’avenir.
Vous savez combien le créole est une langue riche et variée, une langue qui nourrit le français. Comment avez-vous reçu ce Grand prix de l’Académie Française ?
Y. L. Avec une certaine surprise, je dois dire. Mon roman est émaillé de mots ou de phrases en créole mais c’est un texte en langue française. Je ne folklorise pas le créole, comme je ne cherche pas à rendre exotique le vaudou ou le malheur. En Haïti, aujourd’hui, les écrivains utilisent les deux langues comme deux fers distincts au feu. La nouvelle génération d’écrivains et d’écrivaines le font de manière tout à fait claire et renouvellent ainsi les deux langues. Et c’est très bien.
Elizabeth et Régina sont deux prénoms en lien avec une reine. Était-ce vraiment les prénoms de vos aïeules ou les avez-vous choisis intentionnellement pour leur symbolique ?
Y. L. C’est en lisant la question que je prends conscience qu’Elizabeth est un prénom de reine. Les prénoms sont ceux de cette arrière-arrière-grand-mère qui arrive de La Nouvelle-Orléans et de mon arrière-grand-mère. Si j’ai gardé les prénoms, j’ai tout inventé sur les sentiers du songe. La littérature existe pour donner forme et sens à des vies rêvées qui portent en elles une part de vérité.
Elizabeth confie qu’elle est née plusieurs fois et Régina qu’elle a eu plusieurs enfances. Puisent-elles leur force de leur enfance et de leurs renaissances ?
Y. L. Plusieurs naissances et enfances en effet puisque des événements majeurs sont venus marquer des étapes importantes de leur vie. Des événements propres à l’Histoire de ces régions et en lien avec le peu qu’il m’avait été donné de savoir sur ces ancêtres-là.
En lisant Passagères de nuit, on se rend compte à quel point le XIXe siècle dans cette région est peu étudié alors qu’il est singulierement riche culturellement. Était-il important pour vous que le roman s’inscrive dans ce siècle ?
Y. L. Oui, absolument. Ma curiosité a été double. D’abord en me documentant, c’est avec jubilation que j’ai découvert cette ville-monde qu’a été La Nouvelle-Orléans et le rôle énorme joué par l’immigration arrivée de Saint-Domingue dans sa formation, à tous points de vue (économique, linguistique, musical, religieux, culinaire…). Et, de plus, c’est aussi l’Histoire de la France, celle que le narratif officiel passe sous silence. En me documentant sur le XIXe siècle haïtien, s’est confortée en moi l’idée que l’Histoire longue est importante. Elle permet de mieux comprendre la genèse du contemporain. Et faire parler des femmes m’a permis aussi de changer de perspective, de lieu de parole, pour tenter de rendre audible ce qui l’est rarement.
À propos du livre :
Elizabeth est la petite-fille d’une esclave affranchie ayant fui Saint-Domingue pour s’installer à la Nouvelle-Orléans au tout début du XIXe siècle. Elizabeth grandit dans un foyer de femmes où seule la vaillance est de mise. Une nuit, sa grand-mère confie son histoire et la traversée tragique au fond d’une cale puante. À son tour, l’adolescente va devoir faire le trajet dans le sens inverse de son aïeule. Régina, elle, attend la mort et s’adresse à celui qui fut l’amour de sa vie. Elle revient sur son passé et confie sa détermination, ses combats silencieux, ses joies et ses peines. Yanick Lahens trace plusieurs géographies, celle d’une langue et d’une intimité dont tous les affluents mènent aux femmes et à leur force.