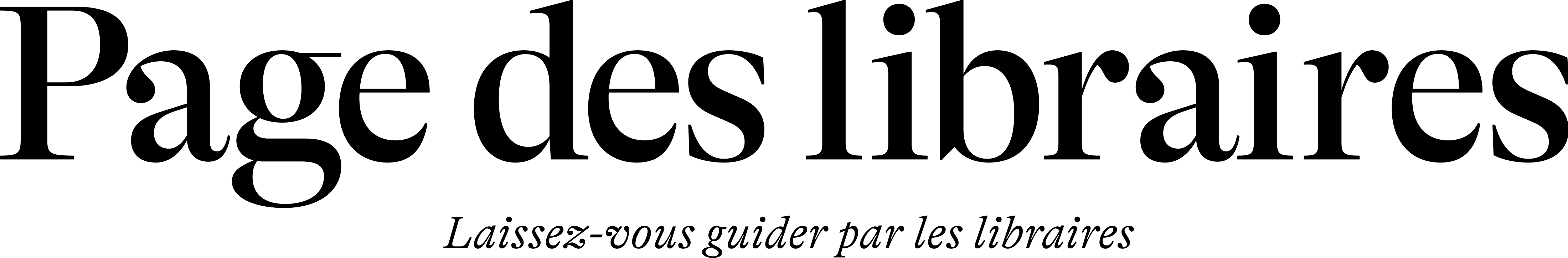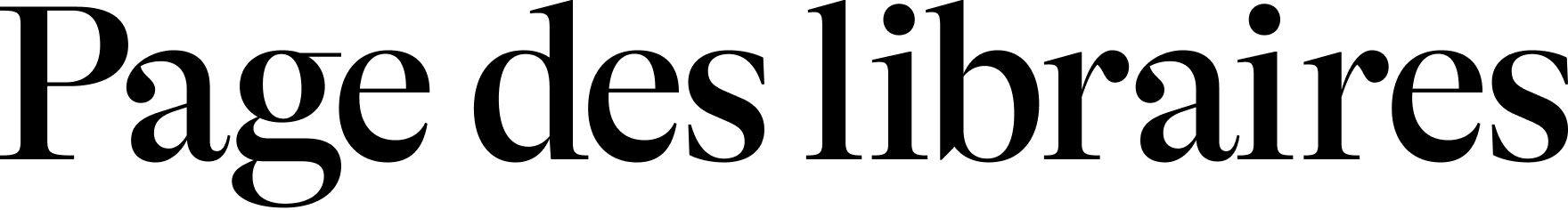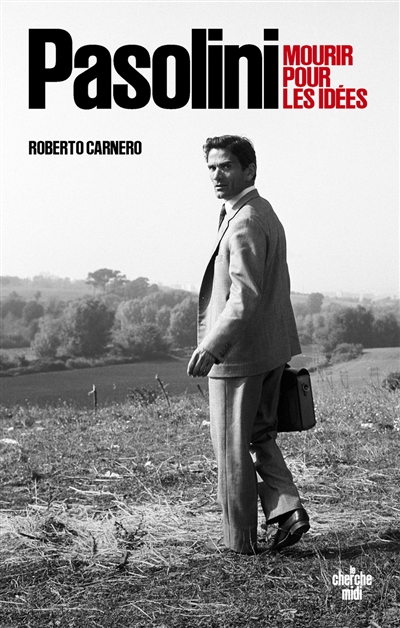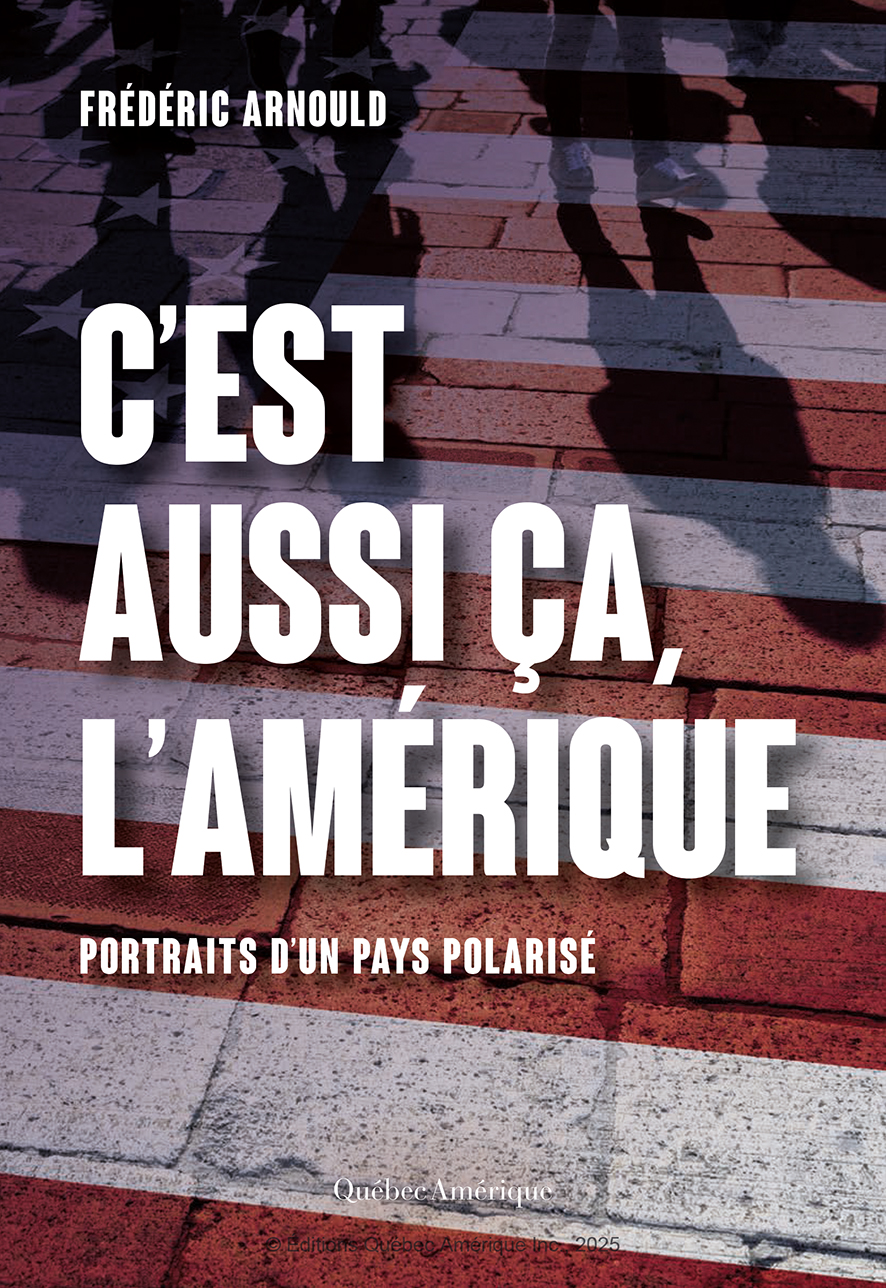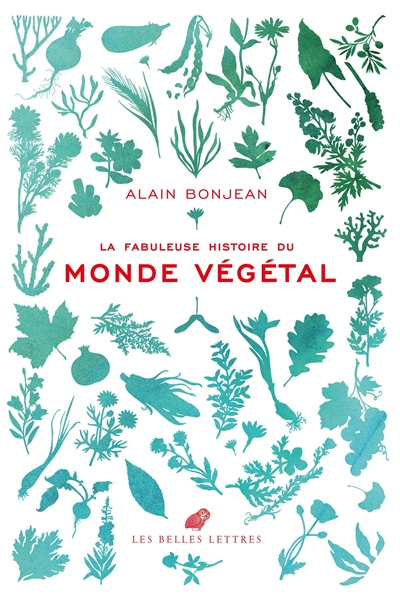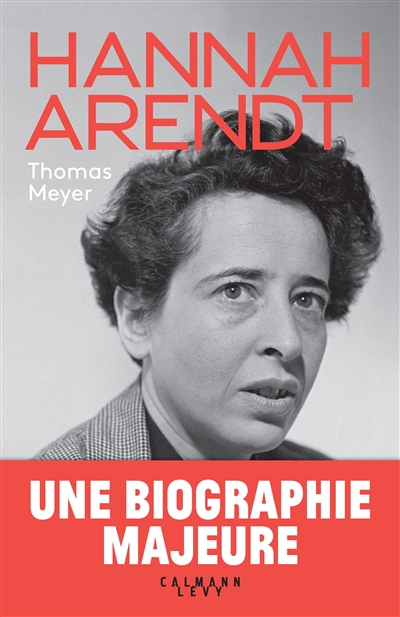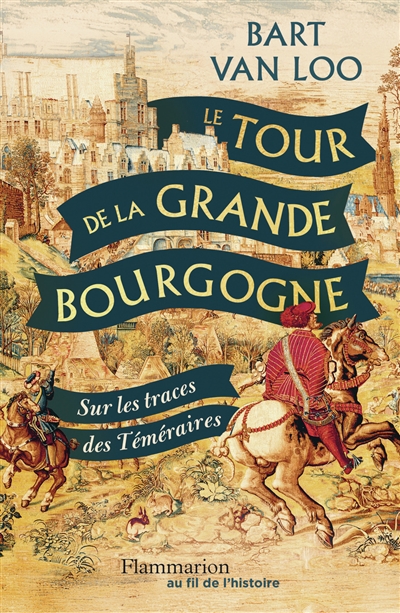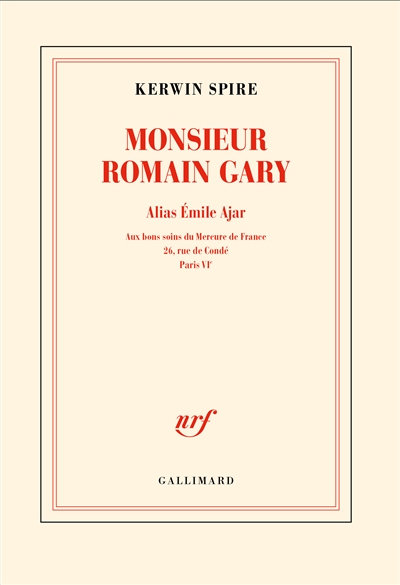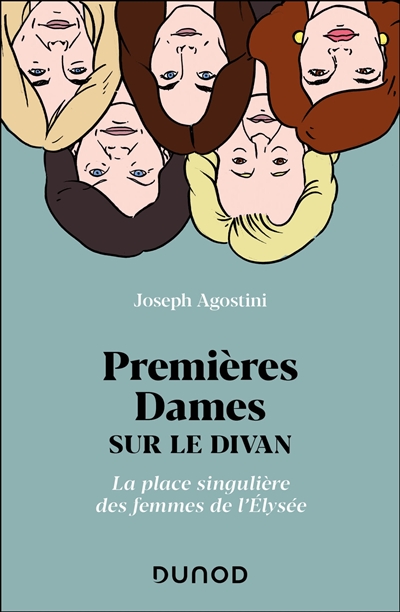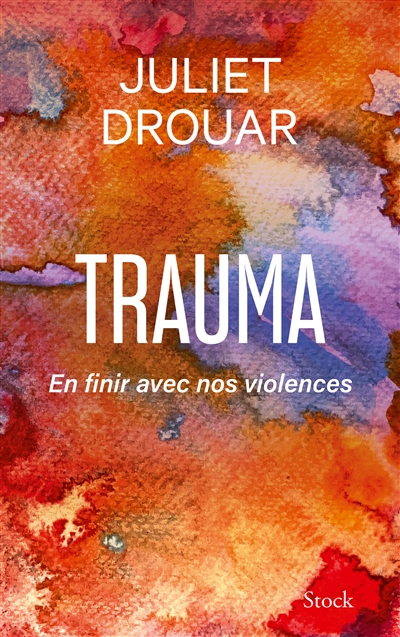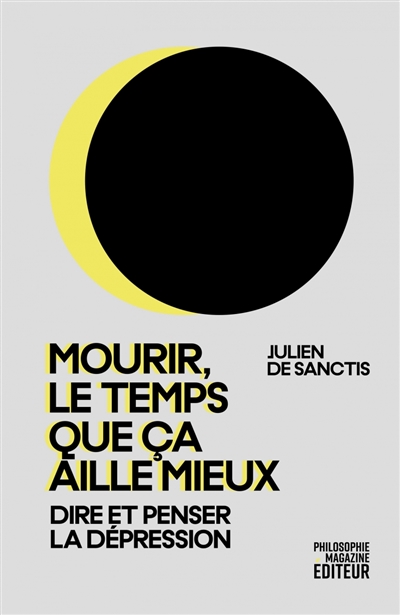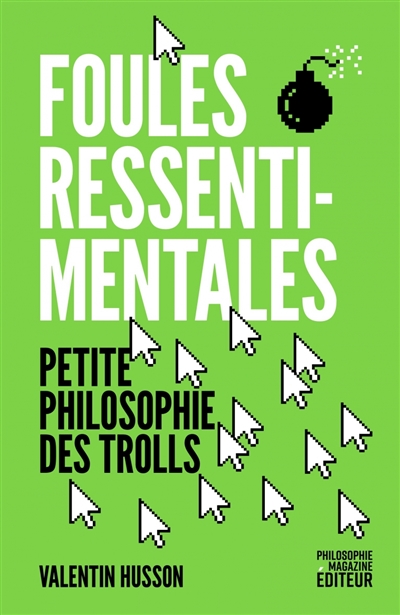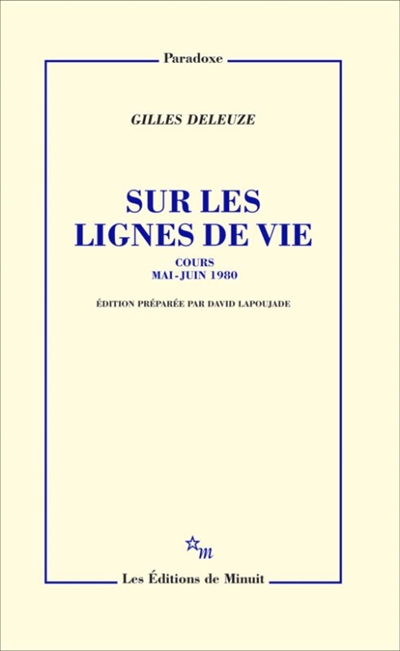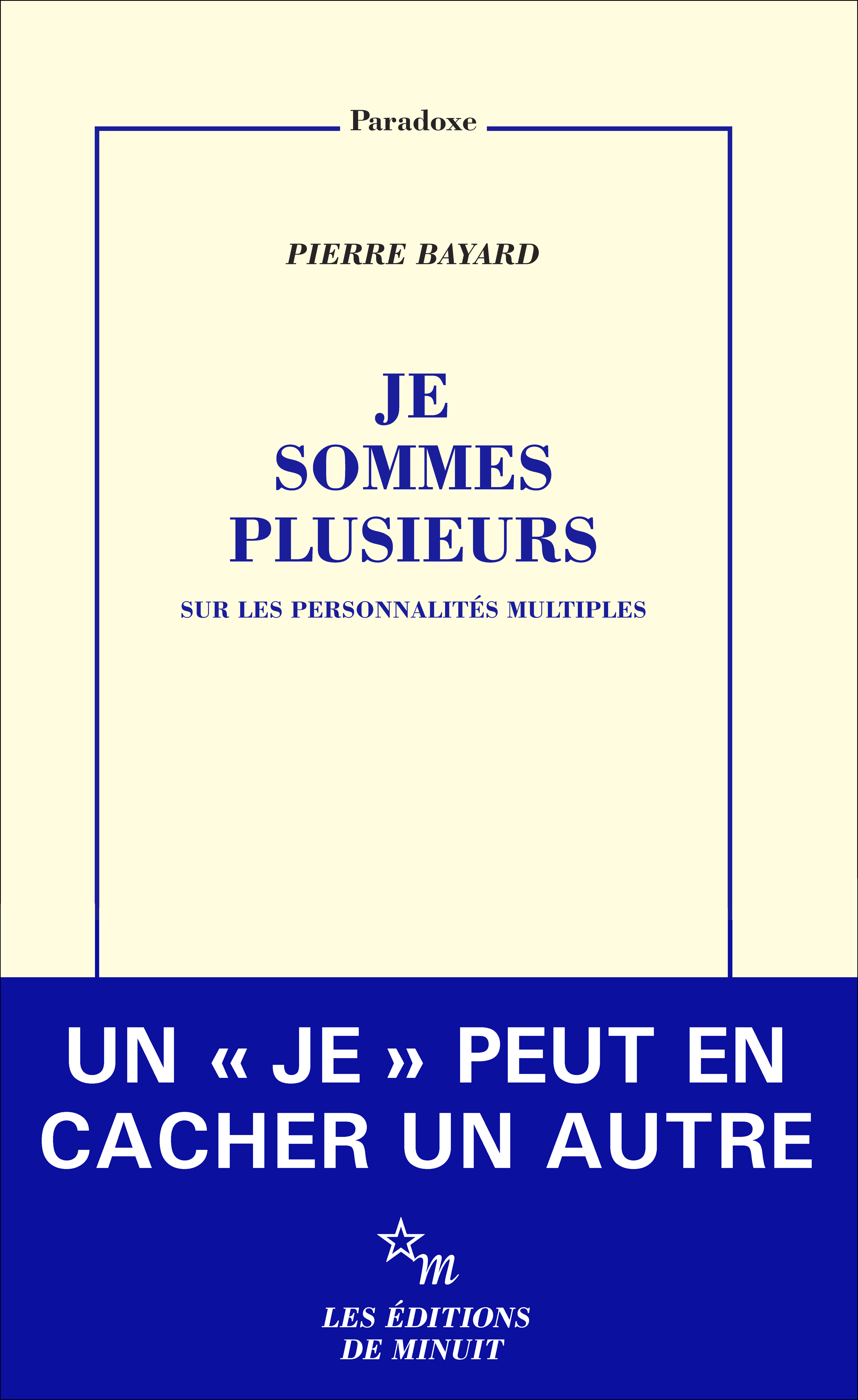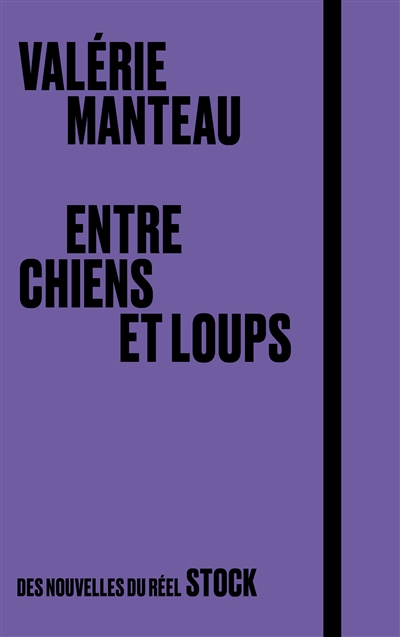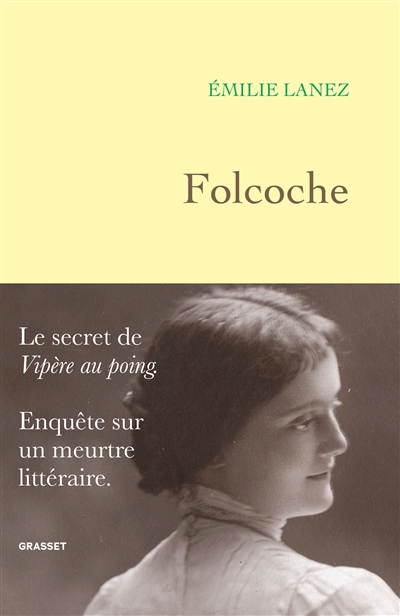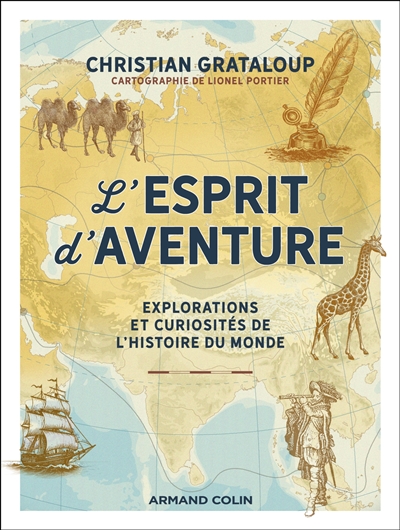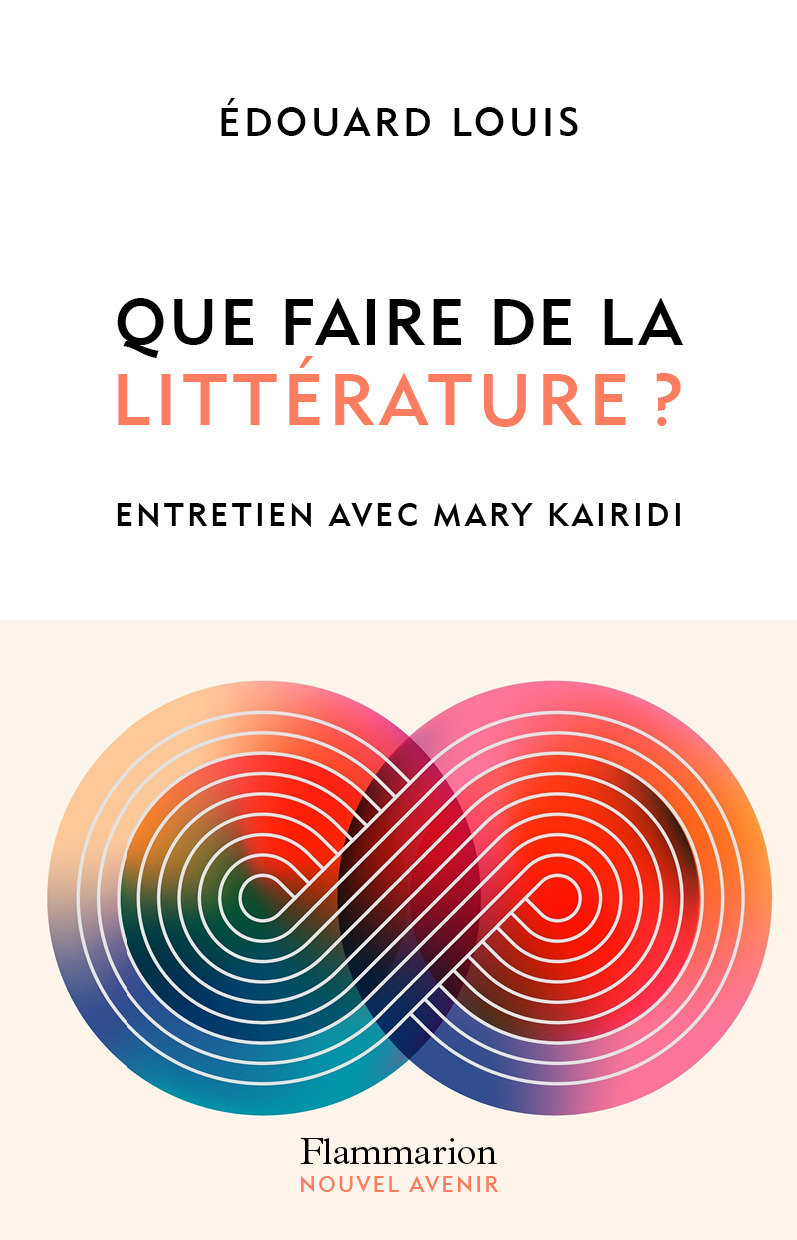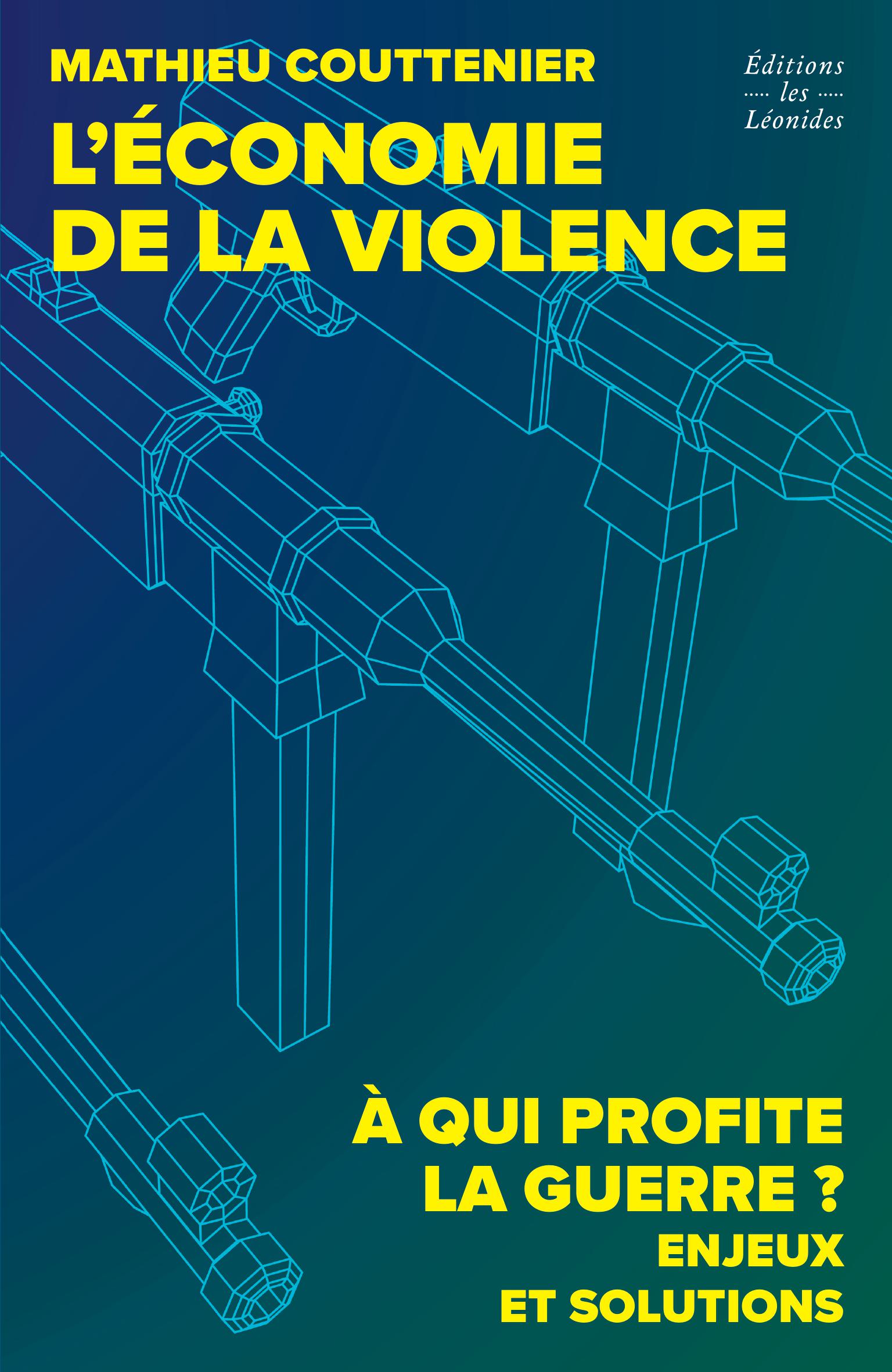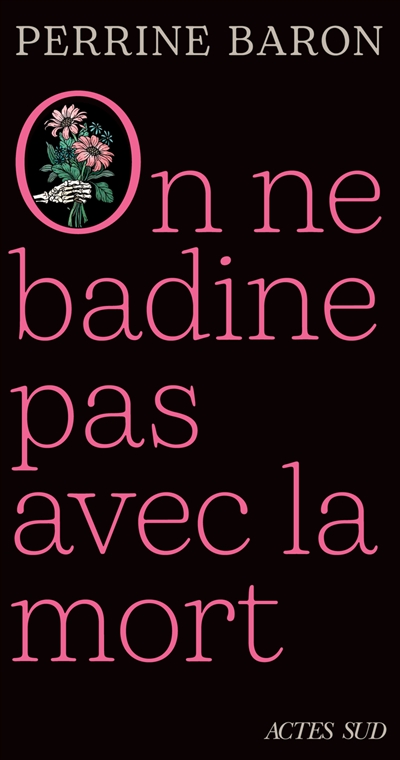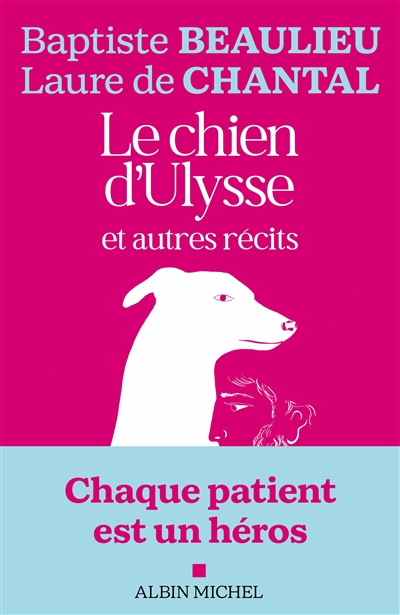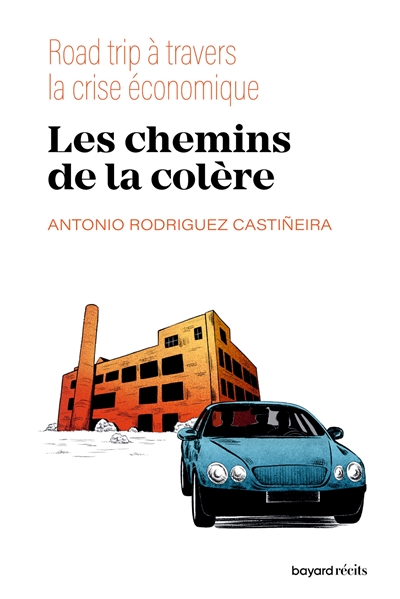Commençons par les spécificités de la collection dans laquelle s'inscrit le livre que vous avez dirigé. Il s’agit à la fois de livres illustrés et collectifs. Pouvez-vous nous indiquer comment vous avez appréhendé ces deux contraintes ?
Arnaud Macé – Nous avons voulu qu’un dialogue s’établisse entre le texte et l’image, en identifiant les aspects du texte qui se prêtaient le mieux à l’illustration, afin que celle-ci, en retour, s’avère à chaque fois une proposition pour entrer dans le texte ou le prolonger. De la même manière, cela a été un grand bonheur pour moi d’avoir la liberté d’un livre ainsi ouvert, où chaque chapitre que j’écrirais pourrait s’ouvrir sur un entretien avec une ou un spécialiste d’un autre domaine ou d’une autre époque, capable d’emmener mes questions vers d’autres horizons.
Quels sont les différents aspects de la république abordés au fil des dix entrées et comment les différentes approches disciplinaires se nourrissent-elles mutuellement ?
A. M. – Il faut lire le livre comme un chœur où les voix se répondent à chaque chapitre, écrit en m’inspirant des Grecs : mon propos et le contrepoint proposé par l’entretien. Je commence par faire revivre le sens ancien de « république », celui de la « chose publique » qui veut en réalité dire la chose ou l’intérêt commun, par opposition aux choses privées et à l’intérêt individuel. Les anciens nous permettent de repenser la république comme une forme d’action collective qui prend soin de biens communs. Claire Judde de Larivière nous emmène alors découvrir le sens de ce commun au sein de la république de Venise. Le livre parcourt ensuite la variété de ce qu’il faut mettre en commun pour faire une république :
- Partager le danger et le risque de mourir pour sauver la liberté commune, en surmontant les guerres civiles. Julien Pasteur présente en réponse cet esprit républicain à travers lequel la société française post-révolutionnaire a cherché à renouer les liens mis à mal par les affrontements de la période révolutionnaire.
- Partager le pouvoir, à tous les étages, de l’école à la municipalité, de l’usine au gouvernement. Vincent Bourdeau explore la manière dont l’action collective, notamment dans le mouvement ouvrier, a pu maintenir vivantes les institutions qui nourrissent la république.
- Partager et protéger des biens communs, comme la terre, l’eau, l’alimentation… L’entretien avec Melissa Lane permet d’examiner ce que Platon peut nous inspirer pour construire les éco-républiques de demain.
- Partager la joie. Ce chapitre explore les sentiments que peuvent procurer une société républicaine, y compris lorsque l’on se retire de l’espace public pour jouir de ce qui reste à soi. Aurélien Aramini explore la question de savoir quelle langue on doit parler dans une république : tous la même ou peut-on profiter de toutes les langues ?
Le ton du livre, aussi précis et rigoureux soit-il, est porté par son sérieux mais aussi un certain optimisme quant à l’édification de cette république idéale toujours à construire. Pourquoi cette forme politique est-elle selon vous si précieuse ?
A. M. – Elle est précieuse parce qu’elle est plus qu’un régime politique : elle est ce qui vit partout où nous agissons ensemble pour faire vivre un intérêt ou un bien commun. En ce sens, une « république » est un feuilleté de pratiques collectives, du conseil de l’école au conseil municipal, de l’association de quartier aux assemblées syndicales – agir au nom de l’intérêt commun est à la portée de chacun. En ce sens, elle n’est pas un idéal, elle est déjà là, tout près de nous.
La France traverse une période politique particulière ces dernières années : quel miroir nous tendent, selon vous, les réflexions sur la chose publique contenues dans votre livre ?
A. M. – Le livre nous rappelle que les républiques ne sont pas éternelles. Elles naissent et elles meurent, soit qu’elles tombent sous les coups extérieurs, soient qu’elles s’effondrent parce que leurs citoyens ont cessé de s’entendre sur l’intérêt commun et ne trouvent plus les manières d’agir au nom de celui-ci. Le miroir des anciens nous suggère qu’il faut à la fois redonner au plus grand nombre l’impression que les efforts et les dangers sont équitablement partagés, et rendre à nos différentes instances collectives la capacité de contribuer chacune à leur façon à l’effort commun.
Nouveau titre de la collection « À l’œil nu » qui se propose de faire découvrir à un lectorat « de 15 à 95 ans » le meilleur de la recherche universitaire, La République, illustré par Emmanuel Polanco, propose, sous forme d'entretiens et d'échanges sur la diversité et la complémentarité des différentes acceptions de ce concept politique, un véritable voyage dans le temps et l'espace autour de cette recherche perpétuelle du bien commun. Loin de se limiter à un régime politique, qu'il soit contemporain ou ancien, c'est aussi un art de vivre : toute sa vigueur et ses potentialités sont ici exposées à travers l'Histoire et la philosophie, pour mieux appréhender ce modèle sociétal toujours d’actualité, et le faire vivre, à tous les niveaux.