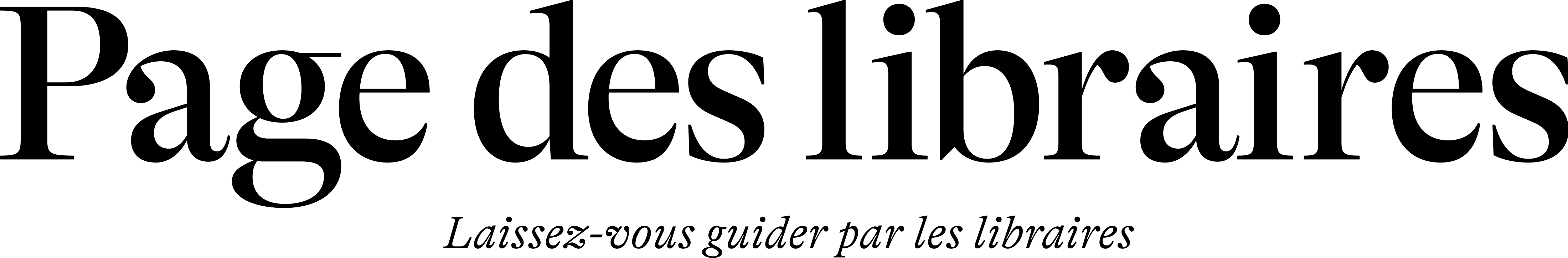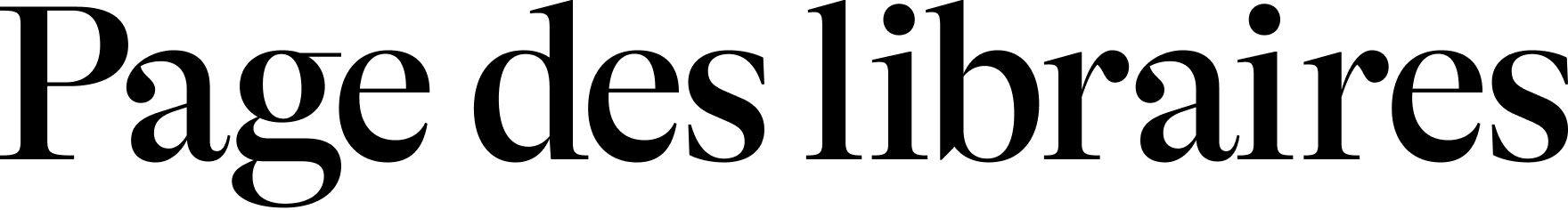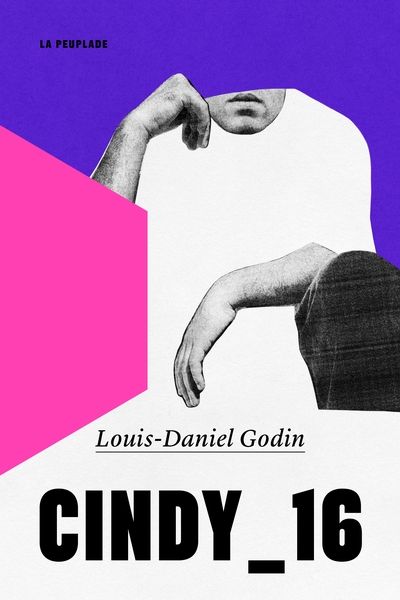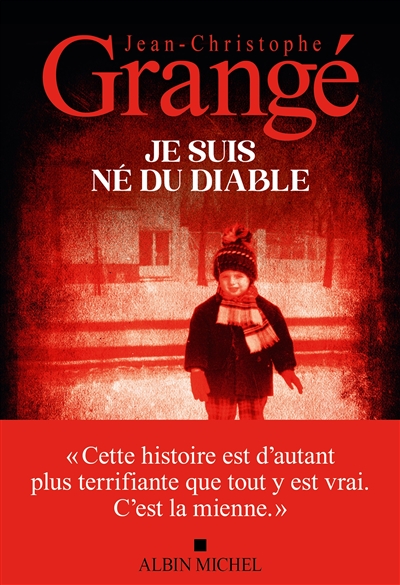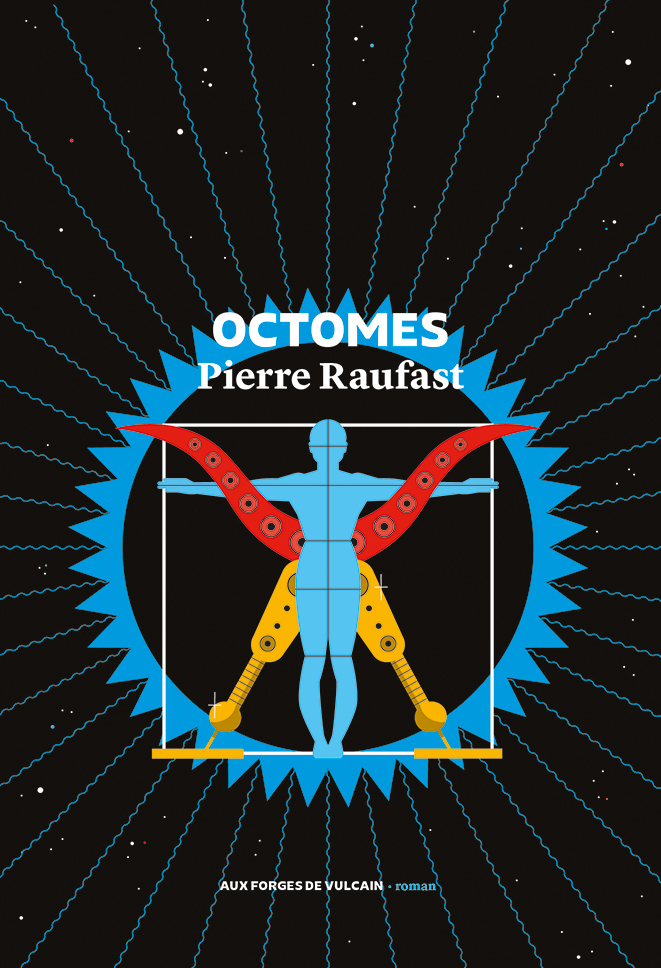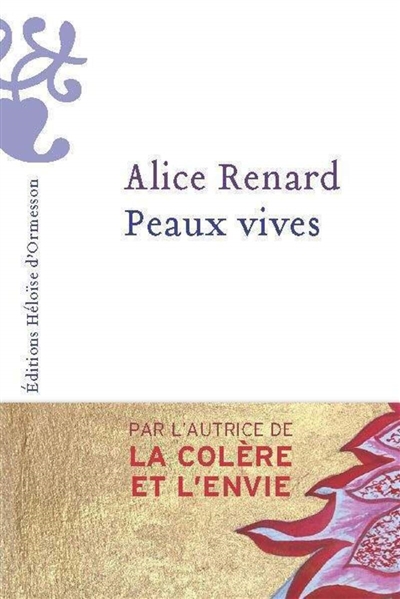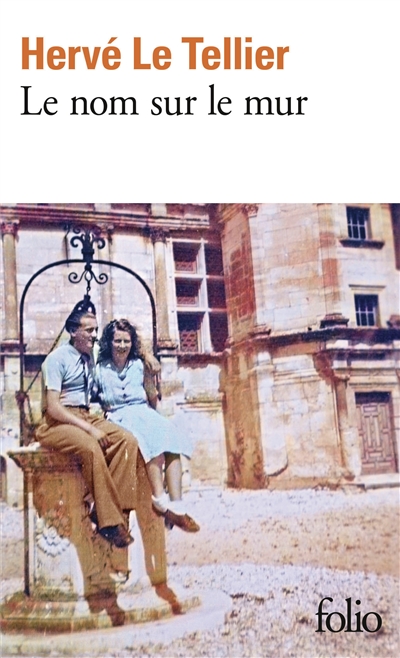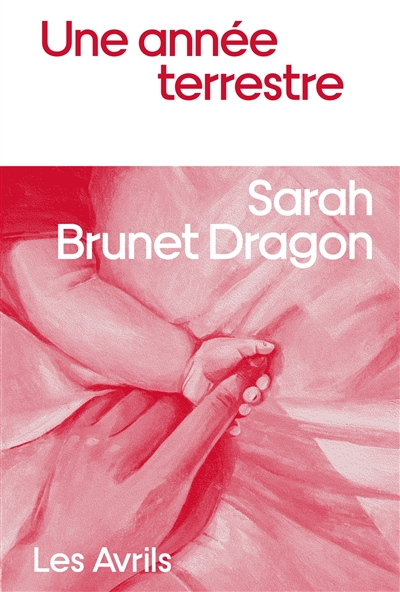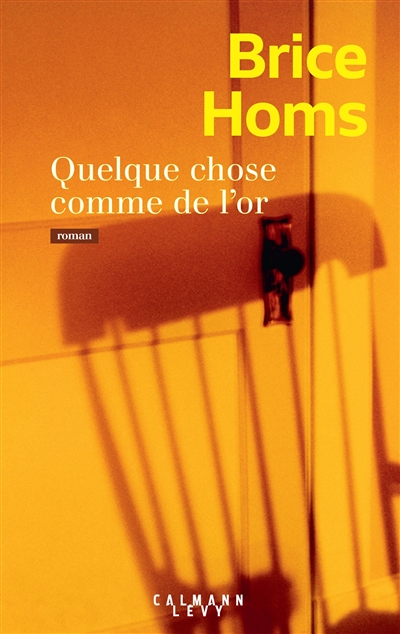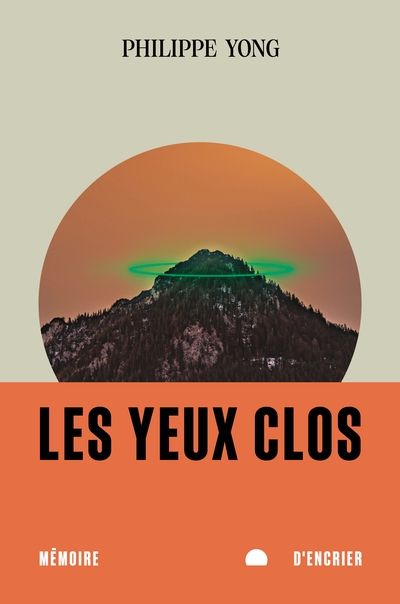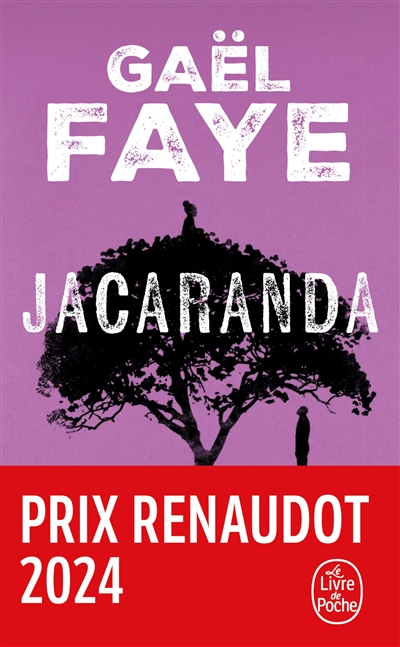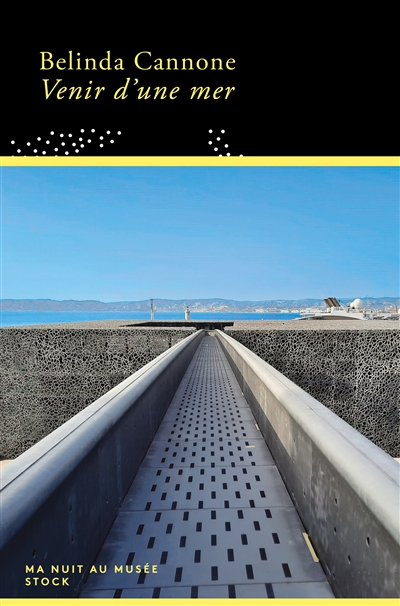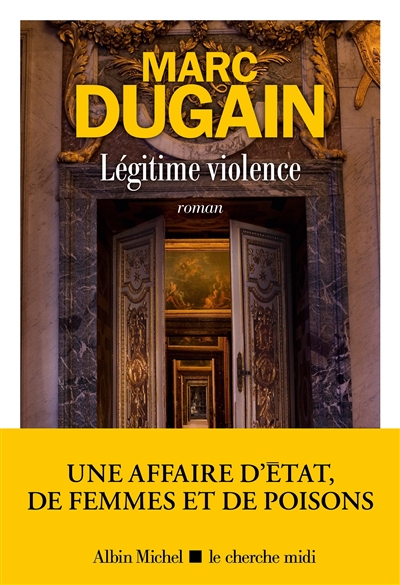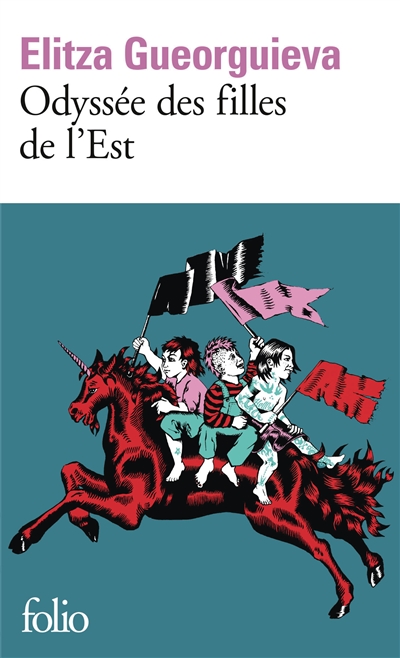Dans Les Ombres du monde, on est au Rwanda avant, pendant et après le génocide. L’histoire se passe en partie en 1990 où l’on suit la rencontre d’Espérance et Jorik, et en partie plus tard en 2024. Pouvez-vous nous parler de cette double temporalité et des personnages d’Espérance et Jorik en particulier ?
Michel Bussi Espérance est une jeune démocrate Rwandaise et Jorik est un parachutiste français qui arrive au Rwanda en 1990. Pendant longtemps m’a hanté cette volonté de réussir à mêler la réalité historique à une œuvre fictionnelle qui permettrait de comprendre une grande partie des enjeux complexes du génocide. Beaucoup de récits sur le Rwanda parlent du génocide mais pas tant des quatre années qui l’ont précédé et qui sont décisives pour comprendre comment on en est arrivé là et comment la France a négligé toutes les alertes qui y ont conduit. Et puis il y avait l’idée de revenir trente ans après car c’est aussi la question de l’identité (Jorik revient au Rwanda avec sa fille et sa petite-fille) et de comment ces identités ont conduit à des secrets, à des choses qui ne peuvent se révéler que tardivement avec une double génération, c’est-à-dire la génération des survivants qui n’ont pas forcément envie de revenir au Rwanda et la génération des enfants.
Depuis combien de temps l’idée de ce texte germait-elle dans votre tête et combien de temps a duré l’écriture ?
M. B. Une trentaine d’années. Je suis entré comme maître de conférences à l’université en 1993 et c’est à peu près à cette période que j’ai commencé à m’y intéresser de près. À l'époque, ce qui m’a marqué, c’est la différence de traitement entre les médias français et la littérature anglo-américaine et belge. J’ai nourri cette histoire tout en souffrant du syndrome de l’imposteur. À un moment donné, j’ai contacté Patrick de Saint-Exupéry qui a été le lanceur d’alerte sur le Rwanda pour dénoncer le rôle de la France. On a passé une dizaine de jours au Rwanda et une grande partie du roman raconte le périple, les lieux de mémoire que j’ai visités avec lui. Grâce à ce travail, je me suis senti la légitimité de me lancer dans cette écriture il y a à peu près deux ans.
Pouvez-vous nous parler un peu plus des sources sur lesquelles vous vous êtes appuyé ?
M. B. J’ai voulu faire un récit qui reste un récit d’action en utilisant les zones d’ombres sur lesquelles on n’a pas encore de clés. C’était mon objectif qu’un lecteur qui n’a pas envie de lire un récit de géographie politique puisse trembler pour les personnages et avoir envie de comprendre. On commence par un coup de fil fictif de l’ambassade de Kigali à l’Élysée au moment où le génocide est déclenché : on demande à parler au conseiller Afrique qui s’est suicidé le lendemain du déclenchement du génocide. Il était le conseiller personnel de Paul Barril qui est soupçonné d’avoir participé à l’attentat contre le président rwandais. J’ai essayé de mêler une grande partie de cette enquête historique à mon fil romanesque. J’aborde dans le roman la complexité des causes et l’identité rwandaise. La construction la plus abstraite de cette identité (puisque les Hutus et les Tutsi priaient le même dieu, parlaient la même langue) va aboutir à la planification d’un génocide. Pour comprendre comment on peut en arriver là, il faut puiser dans les causes et faire un récit à hauteur de survivant mais aussi du point de vue des génocidaires et des militaires.
Comment sort-on émotionnellement de l’écriture d’un tel roman ?
M. B. Quand on passe autant de temps avec une pile de livres sur le génocide, des documents d’archives, des comptes-rendus de l’armée, quelque part on vit en permanence les jours du génocide mais aussi toute la construction qui y conduit. On n’en sort pas indemne. On se retrouve aussi confronté au poids des mots car chaque mot peut avoir une double signification ou pas la même signification selon qu’on est en 1990, 1994 ou 2024. J’ai essayé d’être au plus juste, de manière à ne pas trahir la mémoire des victimes tout en étant à la fois dans la tête des bourreaux. J’espère que dans ce roman on retrouve cette émotion, cet hommage.
En 1990, Jorik Arteta est un jeune parachutiste français envoyé au Rwanda dans le cadre de l'opération militaire Noroît. Il y rencontre Espérance et de leur rencontre va naître une passion amoureuse menacée par les troubles qui s'annoncent. Beaucoup plus tard, en 2024, Jorik est grand-père et s’apprête à retourner au Rwanda avec la fille qu'il a eue avec Espérance et leur petite-fille, Maé. Le safari à la découverte des gorilles qui devait être un merveilleux cadeau de Noël en famille se transforme en cauchemar lorsque Jorik est capturé. Quels secrets cet ancien militaire a-t-il réveillés en se rendant au Rwanda, des années après le génocide ? Que cache-t-il sur son passé ?