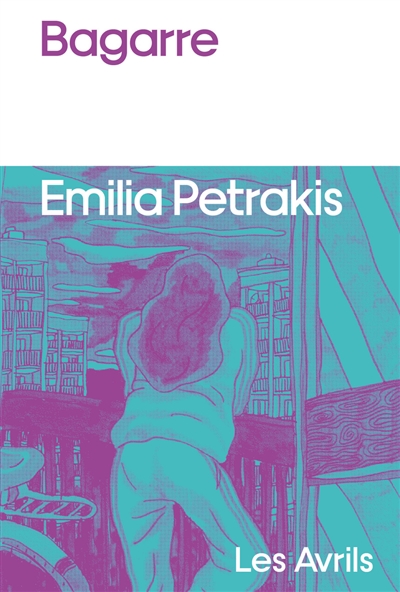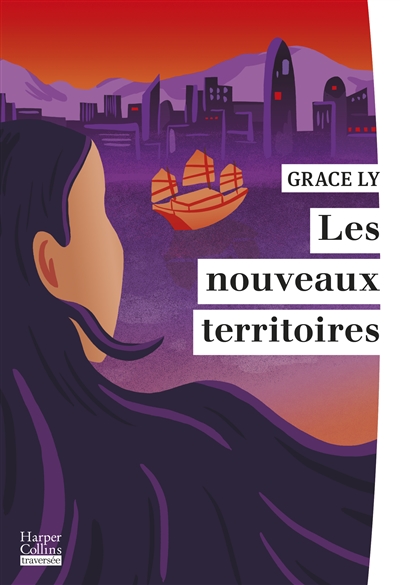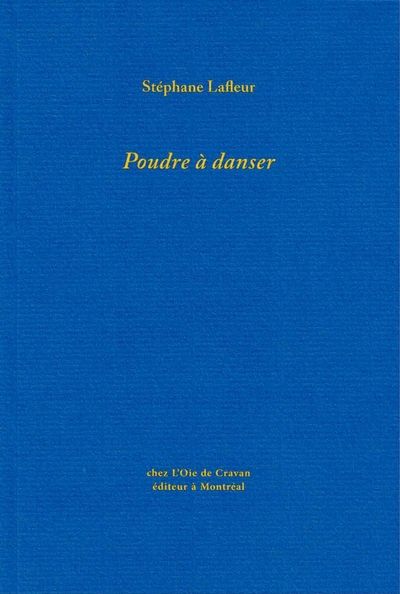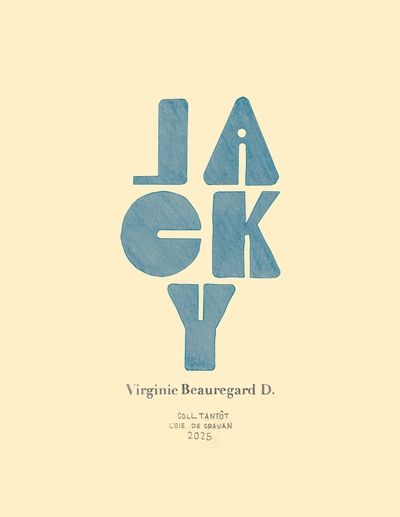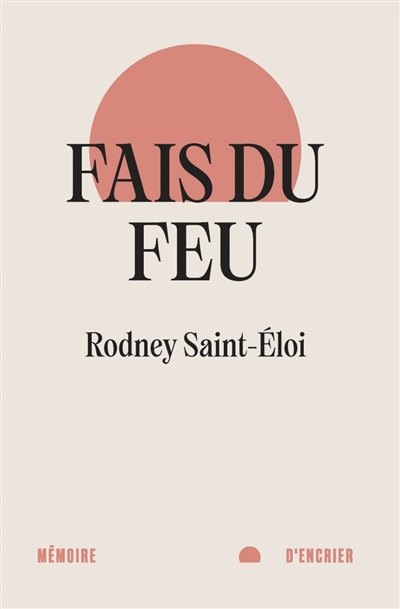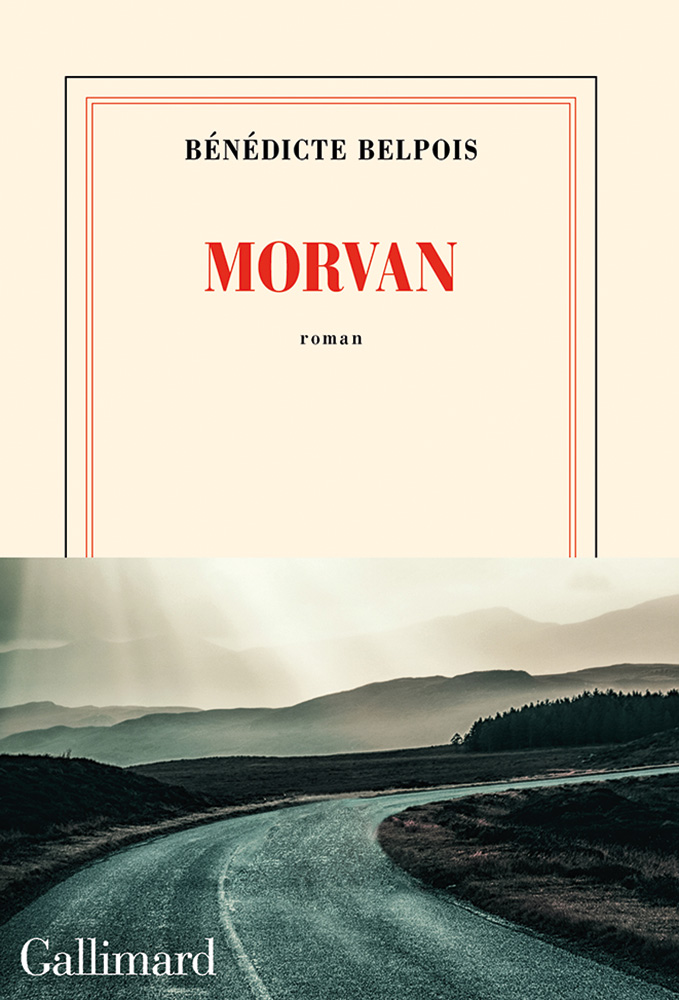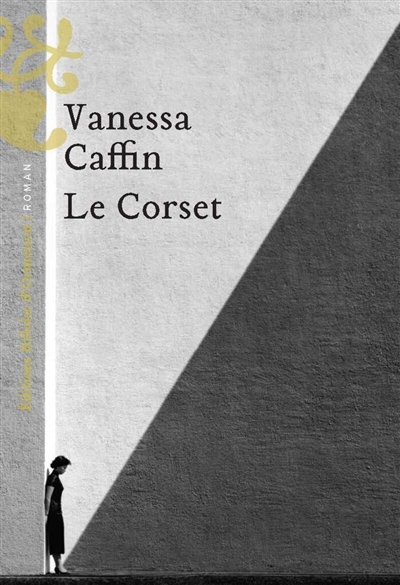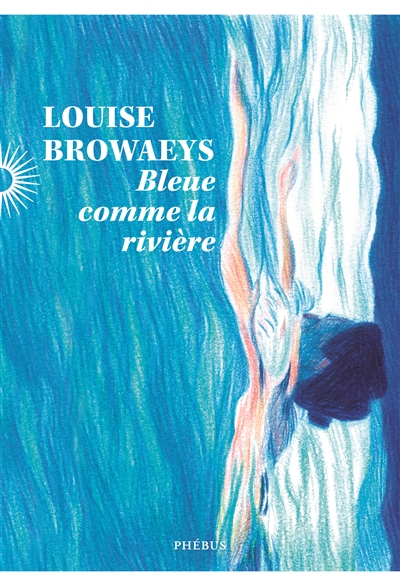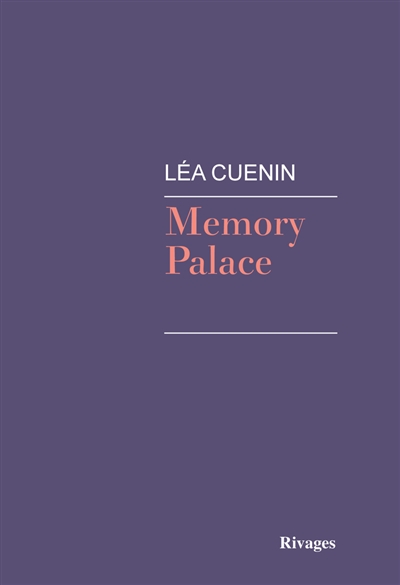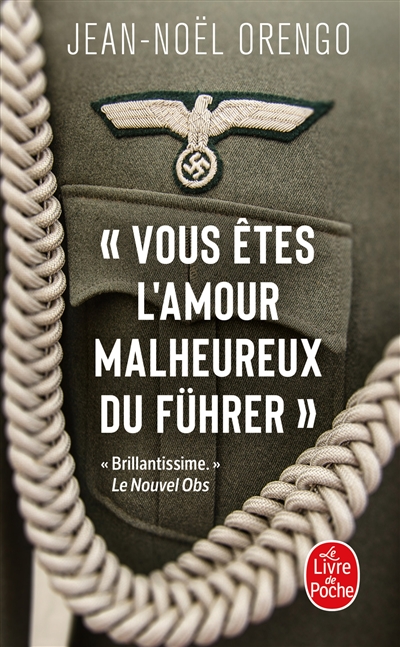Le début du roman se situe dans ce café de Marseillette qui nous semble familier. Il est le principal décor de cette fiction, celui qui rassemble et assemble. Quelle importance revêt ce lieu pour les personnages ?
Olivia Ruiz - Un café, c’est un monde, une micro-société. Le café de Marseillette, dans lequel Carmen va se découvrir, s’incarner et prendre possession d’elle-même, est le centre névralgique du village. C’est là que les langues se délient, que les secrets se partagent, là que les problèmes s’exposent et disparaissent. C’est l’endroit où les âmes solitaires trouvent refuge, là que ces trois sœurs vont pouvoir s’enraciner et enfin trouver une place dans le monde. Ce café, c’est le décor de ma propre enfance puisque j’y ai grandi de ma naissance jusqu’à mes 10 ans. Il est fondateur, tant au niveau de ma personnalité que de ma passion pour les personnages, les atypiques, les âmes perdues… une évidence de le choisir pour être le lieu des rencontres, de l’ancrage et celui des retrouvailles de mes nouveaux héros. Une évidence aussi d’en faire un étouffoir, comme si c’était lui qui allait véritablement faire basculer le destin de Carmen, après l’avoir poussée à bout pour qu’elle parte enfin se confronter à l’horizon. Ce café-hôtel-restaurant-tabac-presse-station-service répond à tous les besoins des habitants du village. Il les tient, les unit, les protège ou les enferme. Pour cela il me semblait mériter d’être un personnage à part entière de ce roman.
Carmen, l’héroïne, vit un deuil terrible dès les premières pages. C’est l’occasion pour elle de revenir sur son histoire et celle de sa famille. Cet événement particulier lui a-t-il permis de faire face à son destin ?
O. R. - Je ne crois pas que ce soit la mort de Cali qui permette à Carmen de faire face à son destin. Le désenchantement induit par la découverte des manipulations exercées par Antonio puis le fait que La Yaya l’éclaire sur la réalité de la guerre d’Espagne et du régime dictatorial de Franco sont les déclencheurs de sa transformation, la réalité des faits étant bien éloignée de ce qu’elle avait pu imaginer jusque-là. Cette prise de conscience et son éloignement, sa rupture avec cet univers vont lui permettre de comprendre que dans cette vie qu’elle haïssait, elle avait eu beaucoup de chance. Dès lors, elle sait qu’elle ne la laissera plus passer sans la saisir et s’en réjouir si elle se présente à nouveau.
Carmen a une vie fascinante et multiple ; elle traverse des épreuves, prend des décisions fortes, se trompe aussi mais se relève toujours. Quelle est la force de ce personnage et pourquoi nous paraît-t-il si proche ?
O. R. - J’avais envie que Carmen prouve qu’on peut se relever de toutes les difficultés, qu’elle démontre que chaque femme possède des forces insoupçonnées si elle se fait confiance et croit en son destin. L’espoir guidait toujours mon écriture, même quand je mettais en scène ses tragédies. Je pensais à leur retentissement comme à autant de forces gagnées pour Carmen. Peut-être que si mon héroïne vous semble si proche, c’est parce qu’elle est un peu de l’adolescent, en colère, démuni ou dans l’incompréhension, qui subsiste en chacun de nous. Peut-être qu’il est tout à fait courant d’avoir un temps envie de pousser les parois de son cocon et que c’est quelque chose d’inhérent à beaucoup d’entre nous, particulièrement en milieu rural, avec cette sensation d’être loin de tout.
Comme dans La Commode aux tiroirs de couleurs, la famille tient une place essentielle au cœur du roman. Elle n’est pas toujours tendre mais porte des jugements justifiés et assumés.
O. R. - La famille a cette étonnante capacité à être tout ou son contraire, éventuellement les deux à la fois. Elle peut être un miracle, un salut, un poids, un poison, donc une source d’inspiration infinie. Les êtres s’éloignent et se rapprochent et, telles leurs relations, ils sont en évolution constante, avec l’historique (aux deux sens du terme) comme pilier ou fléau. Le trop d’amour, comme dans le cas de Carmen, peut lui aussi avoir sa part de nocivité.
Dans ce nouveau roman, il y a aussi la présence de l’Espagne, avec toute l’étendue de son Histoire. Ce pays est-il le terreau de votre inspiration ?
O. R. - La sororité, la quête, le migrant, le résilient, les femmes, les liens familiaux, amicaux, la Méditerranée, ses couleurs, ses odeurs, la psychogénéalogie, le cinéma, la musique… sont tout autant le terreau de mon inspiration que l’Espagne en elle-même. Bien sûr, écrire avec la guerre et la dictature en toile de fond me permet de rendre hommage aux miens entre les lignes.
À propos du livre
Carmen a 40 ans. Après le départ du café qui ne suffisait plus à nourrir ses rêves d’ailleurs, une vie rocambolesque et vécue avec entièreté, Carmen revient et retrouve sa famille, à la fois différente et inchangée. Carmen pleure alors la disparition de sa nièce, symbole de l’unité de cette famille. Ce chagrin est l’opportunité pour elle de se rappeler les personnages qui ont bercé, bousculé et enlacé sa vie. Avec ses sœurs, elle partage le poids de l’exil mais Carmen, elle, a voulu s’affirmer, tracer sa voie, se réinventer, au risque de chamboulements intérieurs. Ce roman est un hymne au mouvement, au cœur qui bout, à l’appel des grandes destinées. Il pétille de vérités et de bienveillance. Une vraie douceur.