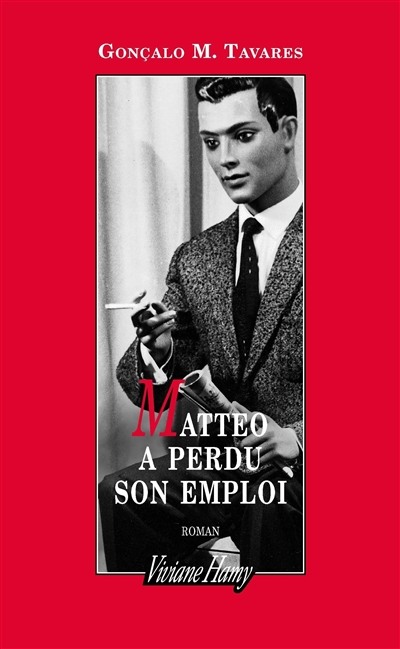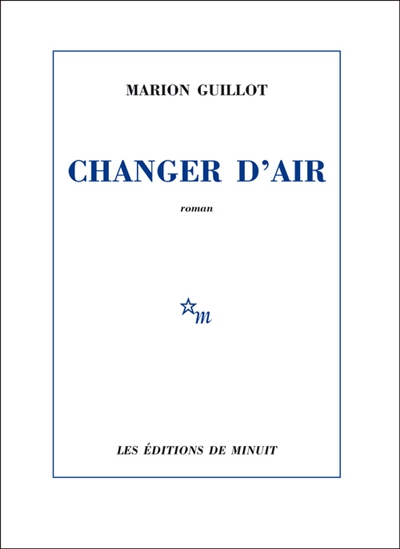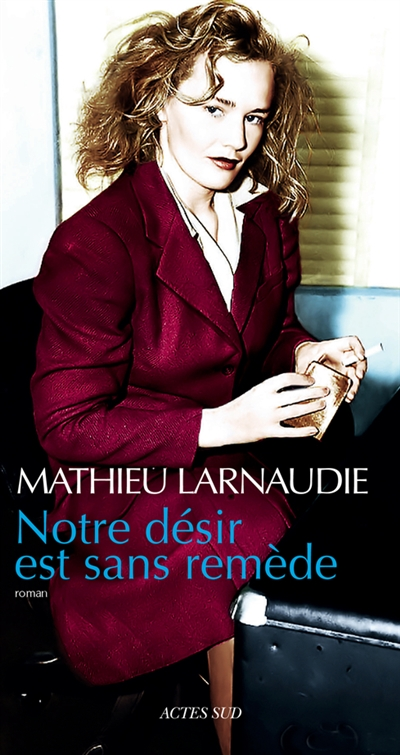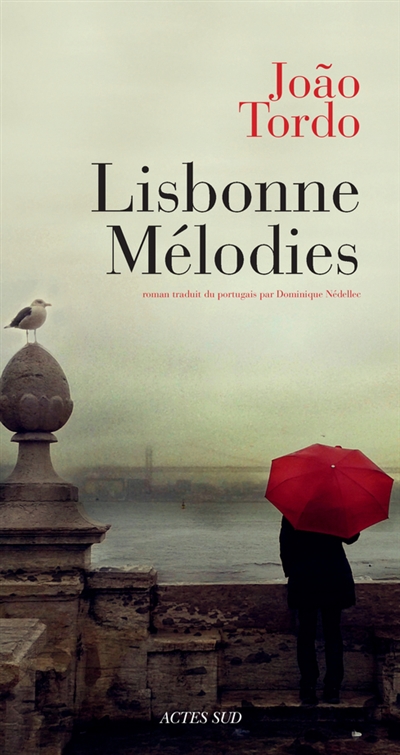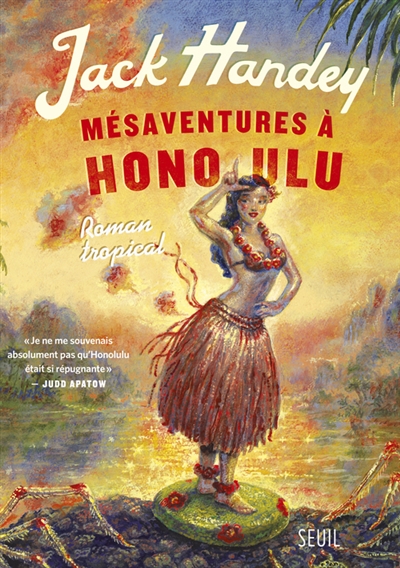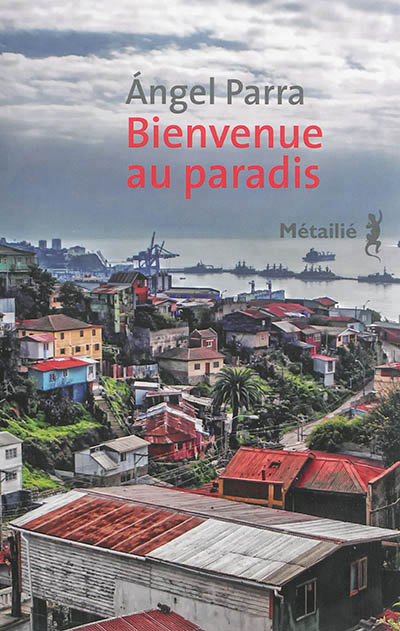Littérature étrangère
Enrique Vila-Matas
Marienbad électrique

-
Enrique Vila-Matas
Marienbad électrique
Traduit de l’espagnol par André Gabastou
Christian Bourgois éditeur
03/09/2015
128 pages, 15 €
-
Chronique de
Vincent Ladoucette
Librairie Privat (Toulouse) -
❤ Lu et conseillé par
2 libraire(s)
- Béatrice Putégnat
- Vincent Ladoucette de Privat (Toulouse)
✒ Vincent Ladoucette
(Librairie Privat, Toulouse)
Avec l’érudition éblouissante qui le caractérise, Enrique Vila-Matas expose dans Marienbad électrique ses idées sur l’œuvre de Dominique Gonzalez-Foerster, le cinéma, l’art de la conversation et ses propres manières de travailler, prouvant une nouvelle fois que la littérature peut divertir et enrichir dans un seul et même mouvement.
Page — Avez-vous pensé Marienbad électrique comme un prolongement d’Impressions de Kassel (Christian Bourgois), ouvrage dans lequel vous vous interrogiez déjà sur l’art contemporain ?
Enrique Vila-Matas — Marienbad électrique semble être un complément à Impressions de Kassel, mais ce n’est pas moi qui ai eu l’idée de l’écrire. Quand Dominique Bourgois, mon éditrice française, a appris que le centre Pompidou avait programmé une rétrospective de mon amie Dominique Gonzalez-Foerster en septembre, elle m’a chargé d’écrire quelque chose sur notre relation artistique, pour parler de la curieuse énergie créatrice qui avait suscité notre amitié. Cela a sans doute été une bonne idée.
P. — Quels sont les points communs qui vous paraissent évidents entre votre travail et celui de Dominique Gonzalez-Foerster ?
E. V.-M. — Nous employons des techniques similaires, comme la réutilisation de matériaux produits, le déplacement d’objets à des endroits inattendus, la mise en relation d’éléments très différents les uns des autres. Bien que cette façon de travailler paraisse sans importance, je pense que ces connexions redéfinissent ce qui a commencé à se vider de sens.
P. — Le hasard semble occuper une place importante dans le travail de Dominique Gonzalez-Foerster. Qu’en est-il pour vous ?
E. V.-M. — C’est la même chose pour moi. Je me laisse guider par le mystère.
P. — Comment concevez-vous l’acte d’écrire ?
E. V.-M. — Il faut simplement suivre le court de nos idées. Je crois que, comme disait Bernard Quiriny l’année dernière à Marienbad, en quarante ans de pirouettes livresques, l’identité de l’écrivain est devenue sujette à caution, d’autant qu’elle se formule à la lisière de la fiction, de l’autobiographie et de l’essai : une œuvre-labyrinthe, tissant souvenirs et citations à double fond.
P. — Si l’art transforme l’espace, la littérature a-t-elle pour but de transformer la vie ?
E. V.-M. — Après avoir lu un livre de Tchekhov, quand nous sortons dans la rue, le monde est devenu « tchekhovien » pour nous. Lisons Kafka un après-midi ; quand nous revenons regarder à l’extérieur du monde, nous sommes devenus « kafkaïens ». Je pense que notre vision du monde est ce qui peut être transformé à travers la littérature.
P. — Est-ce le doute qui motive votre curiosité intellectuelle ?
E. V.-M. — Tout m’intéresse, tout me passionne, voilà ce qu’il se passe. Je sais que tout ce que je vois peut être écrasé par ma machine à interpréter le monde. Tout peut être « vilamatien » en un seul moment.
P. — Le thème de la disparition, très présent dans votre œuvre, vous paraît-il en opposition avec l’idée d’exposer et de s’exposer ?
E. V.-M. — Pour moi, l’exhibition (Salvador Dalí) et la discrétion (Duchamp) sont complémentaires. À Cadaqués, je me souviens que ces artistes étaient de grands amis. Dans ma famille, mon père parle beaucoup et ma mère est toujours silencieuse. Je suis une combinaison des deux : j’adore m’exposer en public, mais en même temps, je désire être invisible. Je veux parler, mais ma plus grande tendance est au silence.