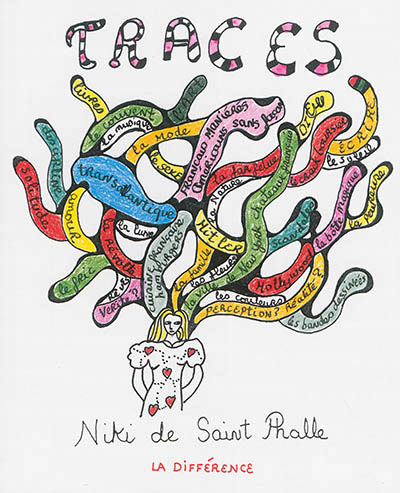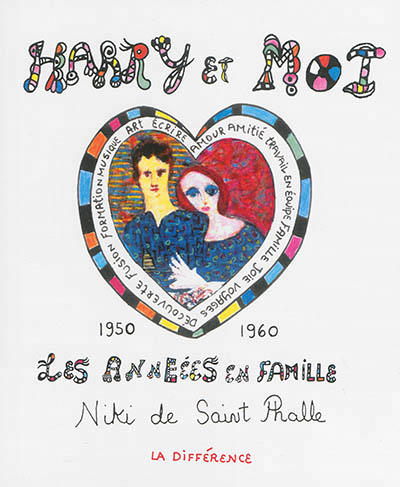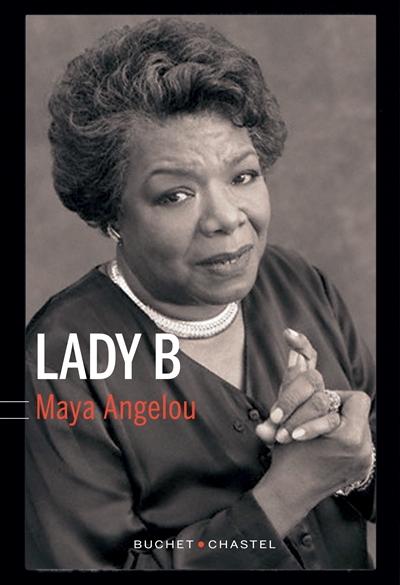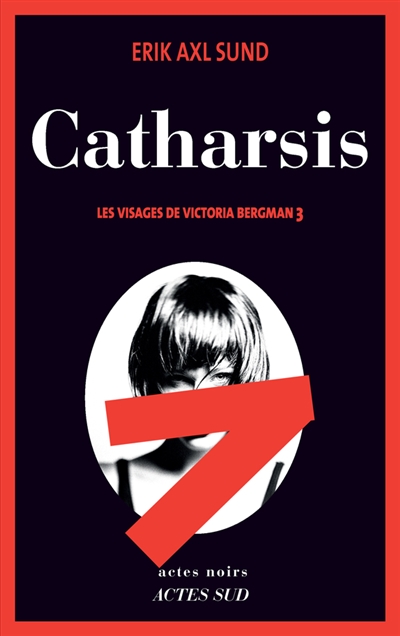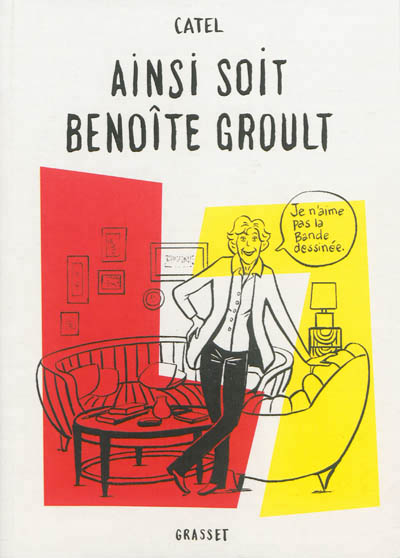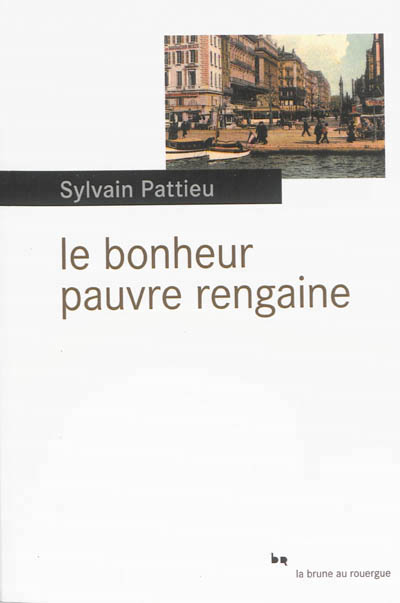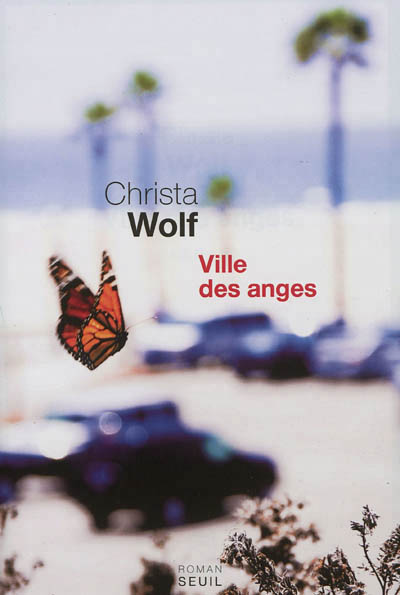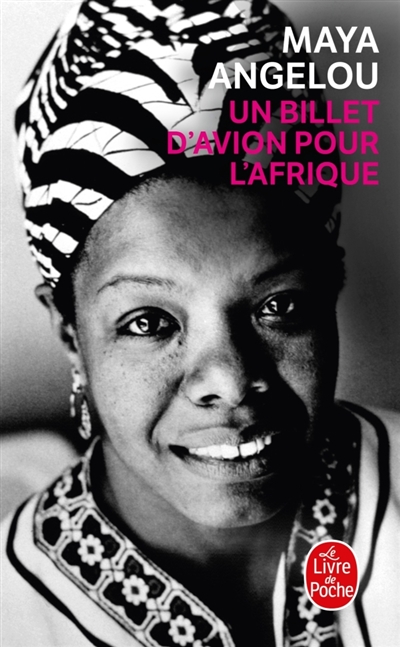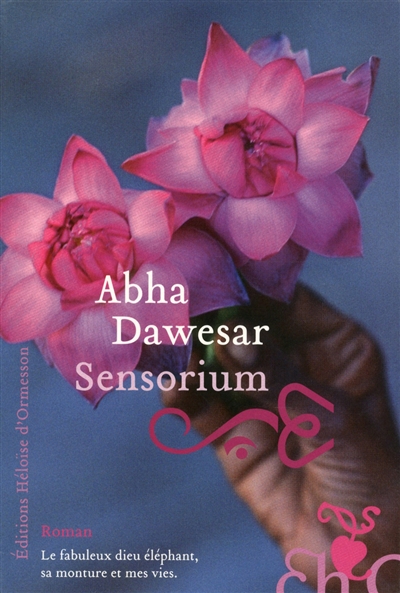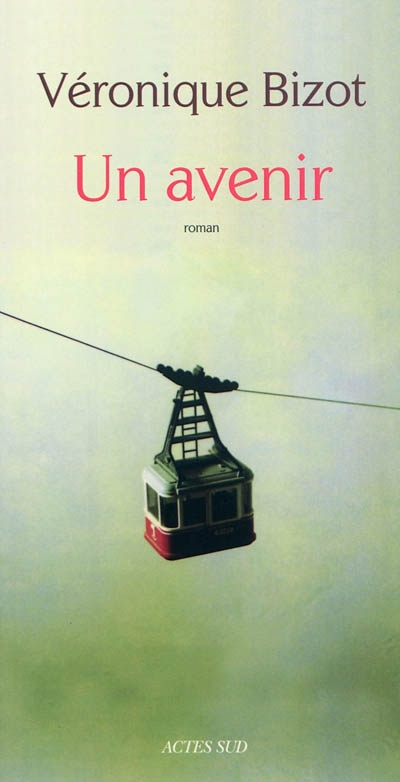Littérature française
Anaïs Barbeau-Lavalette
La Femme qui fuit
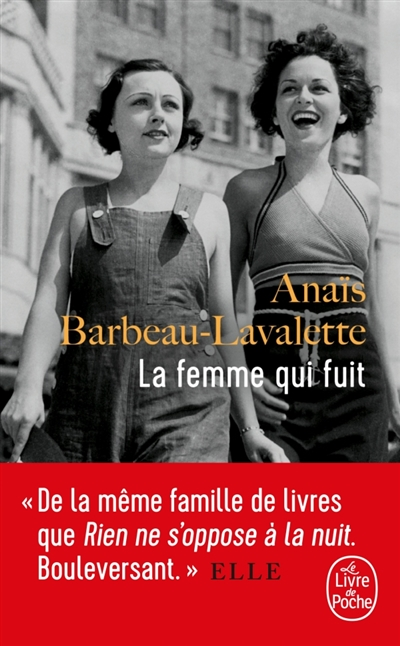
-
Anaïs Barbeau-Lavalette
La Femme qui fuit
Le Livre de Poche
01/03/2017
448 pages, 7,60 €
-
Chronique de
Christine Lemoine
Librairie Violette and co (Paris) -
❤ Lu et conseillé par
7 libraire(s)
- Delphine Bouillo de M'Lire (Laval)
- Cathy Ohanessian de Murmure des mots (Brignais)
- Nathalie Iris de Mots en marge (La Garenne-Colombes)
- Céline Vignon de Mots et Images (Guingamp)
- Claire Lallement
- Annabelle Prat de Maupetit (Marseille)
- Isabelle Dugailliez de L'Oiseau Lire (Visé)
✒ Christine Lemoine
(Librairie Violette and co, Paris)
Lauréate de plusieurs prix littéraires, dont le prix France-Québec, Anaïs Barbeau- Lavalette s’adresse, dans ce roman à vif, à la grand-mère artiste qu’elle n’a jamais connue. Un portrait sincère et poétique d’une femme en errance qui écrivait : « Je cultive les tremblements comme des perles ».
Sortir de l’oubli une artiste vaincue par son époque et se réconcilier avec celle qui a abandonné ses enfants : voilà l’entreprise romanesque de l’écrivaine qui consacre son troisième livre à sa grand-mère maternelle, grande absente qu’elle a détestée avant de tenter par l’écriture de comprendre ce qu’a pu être sa vie. Il reste peu de choses de Suzanne Meloche : quelques tableaux et poèmes, et l’auteure réinvente son histoire à partir de quelques bribes. Née dans les années 1920, ayant quitté très tôt sa famille, elle se lie à Montréal à un groupe d’artistes d’avant-garde, épouse un jeune peintre avec qui elle aura deux enfants dont l’aînée est la mère d’Anaïs. Très vite, elle quitte le foyer et commence une errance qui la mène à New York où elle rencontre Pollock, vit à Harlem, s’engage aux côtés des Noirs américains, vit un amour avec une femme. Elle finira sa vie à Ottawa en n’ayant pratiquement jamais revu sa fille. Un roman magnifique qui interroge la quête de liberté d’une femme prise dans le carcan d’une société rigide.
PAGE — L’héroïne de votre roman est née dans les années 1920 et a donc vécu sa jeunesse dans les années 1940-1950. En France, nous connaissons mal cette période de l’Histoire du Québec. Parlez-nous de ce contexte.
Anaïs Barbeau-Lavalette — C’est une période appelée la « Grande Noirceur », dominée par le clergé qui impose sa loi dans toutes les sphères de la société. Les familles sont contraintes de faire beaucoup d’enfants (sous peine de réprimandes) et l’église dicte toutes les règles de conduite. Ça affecte tout le monde et les jeunes artistes (dont ma grand-mère) d’une façon particulière. En effet, « la loi du cadenas » met à l’index plusieurs auteurs rendant ainsi leur œuvre inaccessible. Les jeunes intéressés par l’art se voient cantonnés dans des discours et des voix d’une autre époque, se retrouvent coupés de l’évolution artistique qui se déploie partout ailleurs. Il est très mal perçu de peindre, d’écrire, de photographier, de danser de façon non-figurative. Ça choque, ça provoque, ça « relève du diable ». Un petit mouvement de jeunes artistes s’unit alors. Ils sont seize et s’inspirent notamment du Manifeste surréaliste porté par Breton en France. Peintres, photographes, danseurs, poètes : ils ont entre 20 et 40 ans et signent le Manifeste de Refus Global, qui marquera ici le début de la Révolution tranquille. On dit de ce manifeste, porté par le peintre Paul-Émile Borduas et signé, entre autres, par Jean-Paul Riopelle, Claude Gauvreau et Marcel Barbeau (mon grand-père), qu’il ouvrira les portes de la Révolution au Québec.
P. — Le titre de votre livre implique déjà une position par rapport aux choix de Suzanne. Fuit-elle vraiment ou est-elle simplement celle qui part à la découverte d’une réalité autre ? À la découverte d’elle-même aussi, d’abord en quittant très jeune ses parents, puis ses enfants et son mari (qui ne lui laisse aucune place en tant qu’artiste alors que lui-même abandonne aussi son foyer pour peindre), puis le Québec ?
A. B.-L. — L’abandon des enfants, c’est le geste fondateur de Suzanne. C’est là qu’elle devient « la femme qui fuit ». Je pense que Suzanne passera ensuite toute sa vie à fuir cette blessure-là, reliée à son immense culpabilité. Oui, elle part à la poursuite d’elle-même, elle cherche à vivre, elle cherche à s’accomplir. J’ai de l’admiration pour ça. Mais elle n’y arrivera pas. Elle restera toujours en orbite de sa propre vie. Jamais elle ne s’enracinera, ni en amour, ni en amitié, ni artistiquement d’ailleurs. Parce que sa blessure restera trop vive et sa culpabilité trop oppressante. Avant que je ne commence ce livre, elle se résumait à son geste. Elle n’était que celle qui a abandonné. Mais en écrivant, je me suis tranquillement rapprochée d’elle, l’ancrant dans un corps, dans une époque, dans une réalité. Et je me suis mise à l’aimer.
P. — Suzanne Meloche a été peintre et poète mais n’a laissé que peu de traces. Pourquoi n’a-t-elle pas continué à créer alors qu’elle était « libre » ?
A. B.-L. — Justement parce qu’elle est devenue celle qui fuit. Parce qu’elle n’a jamais pu, je crois, exister vraiment ailleurs. Je pense que la rupture avec ses enfants l’a finalement empêchée de se déployer, à tous les niveaux. C’est malheureux. Je peux par contre aujourd’hui affirmer que moi, sa petite-fille, je suis celle que je suis grâce à elle. Grâce à ce parcours atypique. Elle aura tout de même réussi à semer en moi un désir immense de concilier racines et liberté.
P. — Parlons de votre style, fluide, factuel avec des fulgurances poétiques. L’écriture de votre grand-mère vous a-t-elle influencée ? Vous êtes aussi cinéaste. Comment abordez-vous l’écriture littéraire par rapport à l’écriture cinématographique ?
A. B.-L. — J’écris au présent et je m’adresse à ma grand-mère, au « tu ». Le choix me semblait évident et était d’abord plutôt instinctif. Mais rapidement, je me suis rendu compte que grâce au choix du deuxième pronom, je côtoyais enfin ma grand-mère. Derrière le « tu » se cache inévitablement un « je ». Nous étions ensemble, enfin réunies, sur plus de 300 pages ! Je ne crois pas que l’écriture de ma grand-mère m’ait directement inspirée, mais j’ai eu beaucoup de plaisir à plonger dans sa poésie, à redécouvrir toute sa liberté, tellement révolutionnaire à l’époque ! C’est peut-être rythmiquement que mon métier de cinéaste nourrit le plus mon écriture. Dans le désir de créer un rythme qui sied au récit, comme le montage le fait avec des images. Les phrases sont courtes, le rythme parfois saccadé : je poursuis la femme qui fuit. Une chose que permet l’écriture et qui me semble plus difficile en écriture cinématographique est le déploiement d’une certaine sensualité. Les odeurs, par exemple, ou les goûts. J’aime trouver l’image juste pour raconter les sens, ils nous rapprochent des personnages.