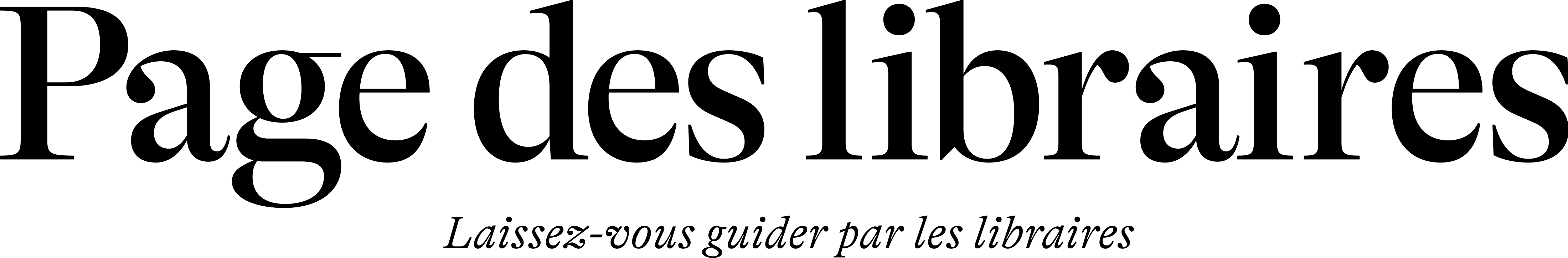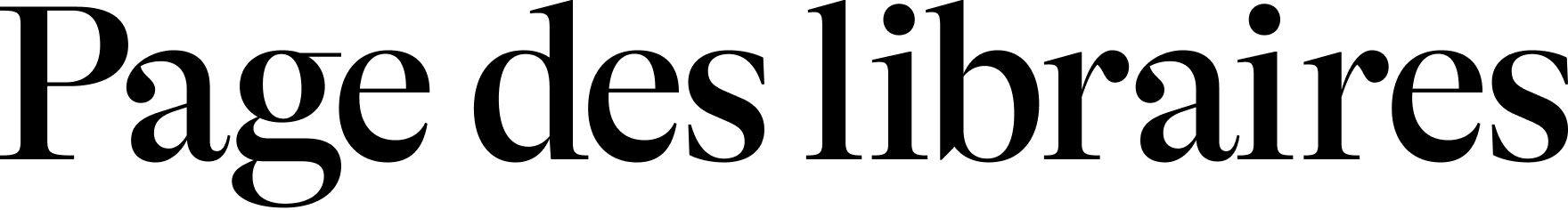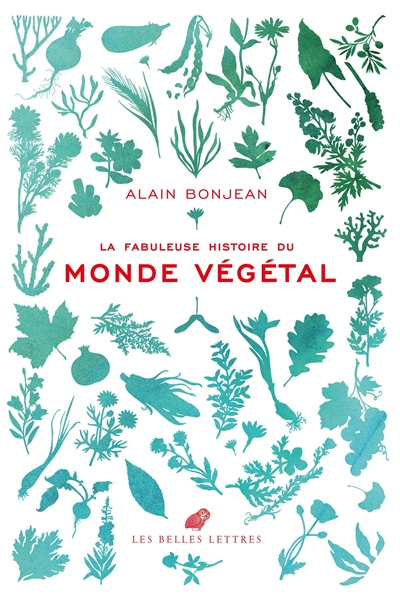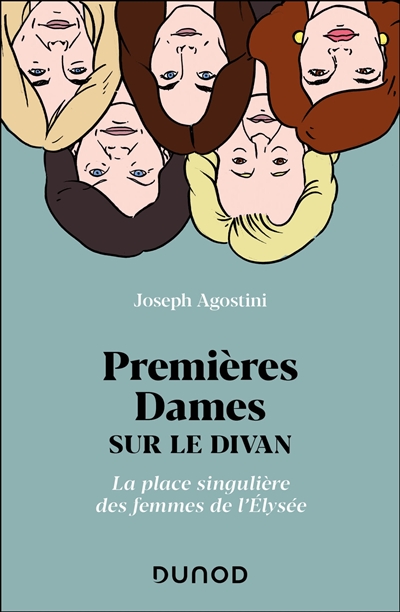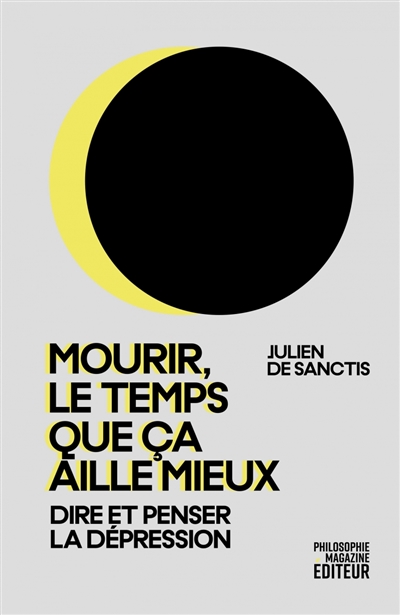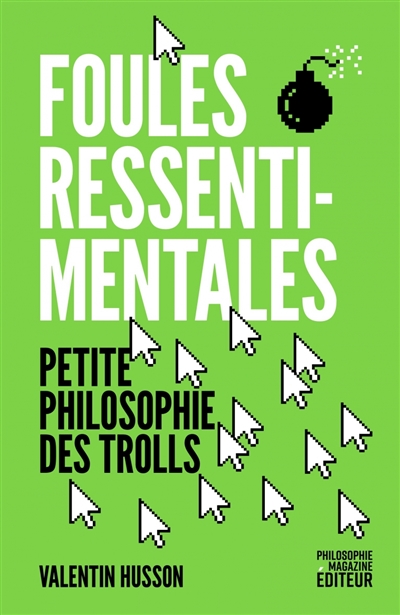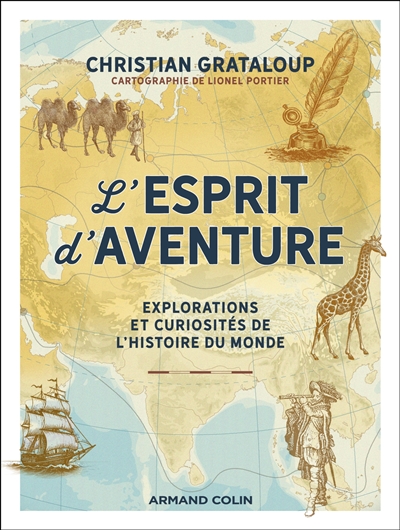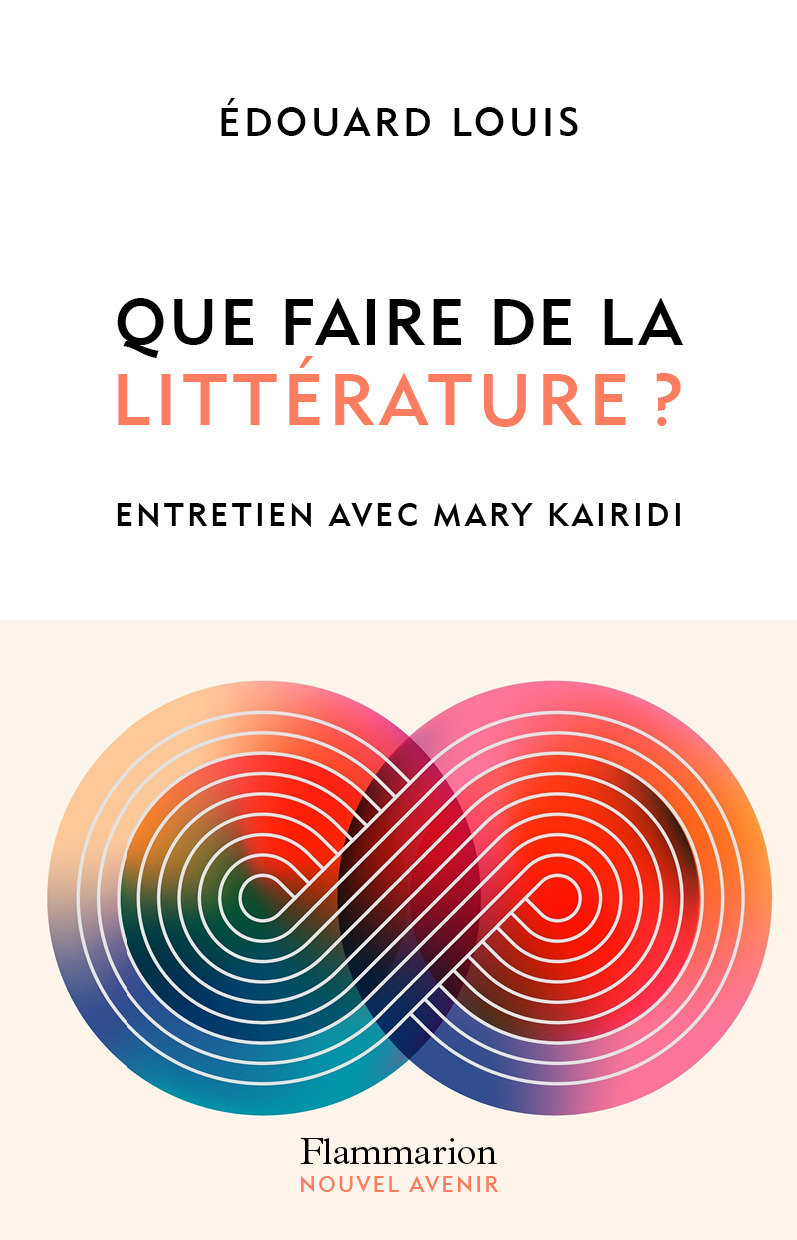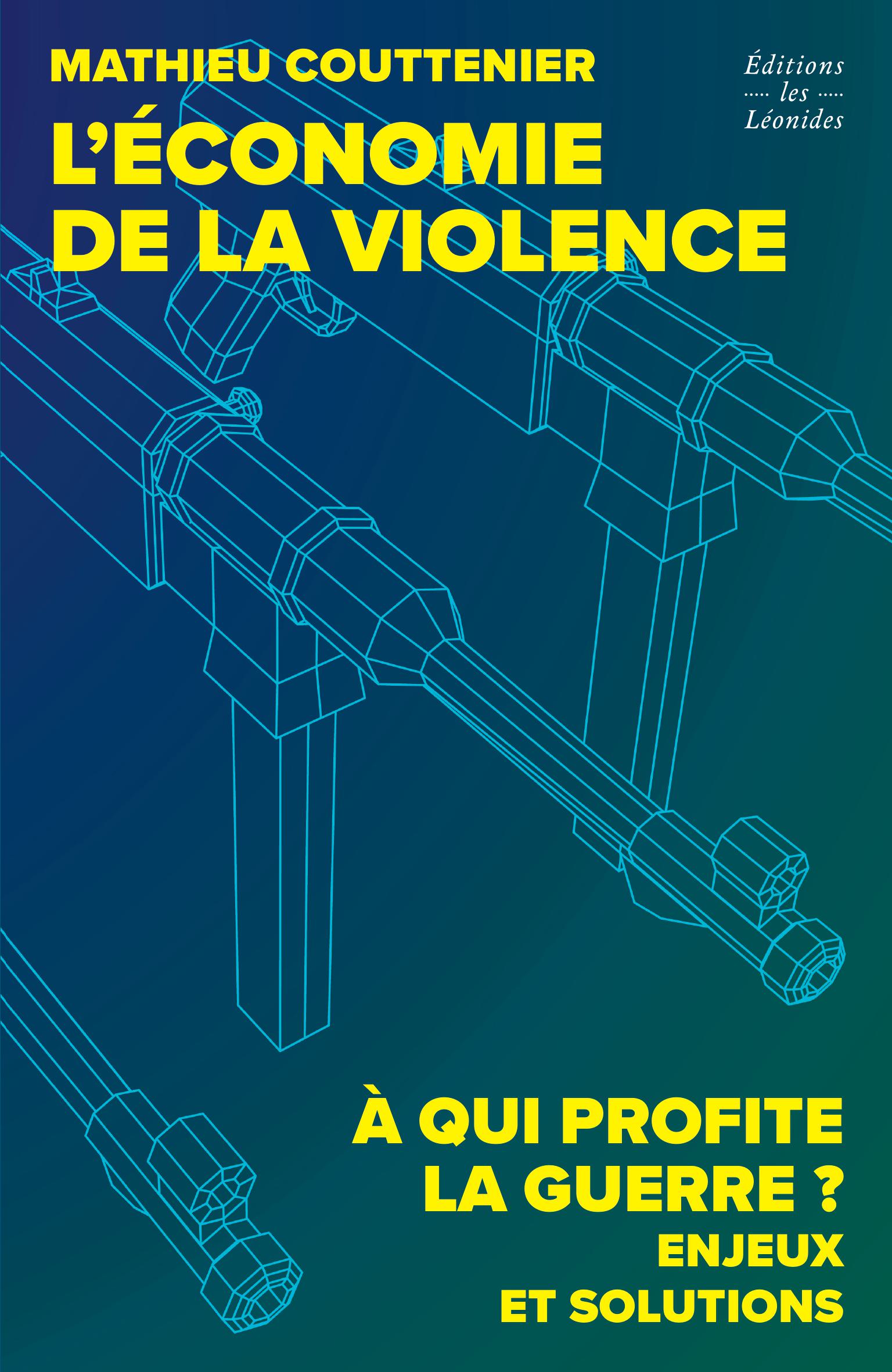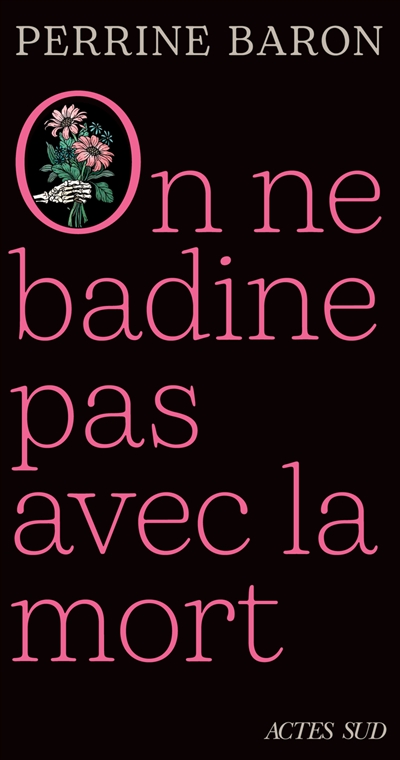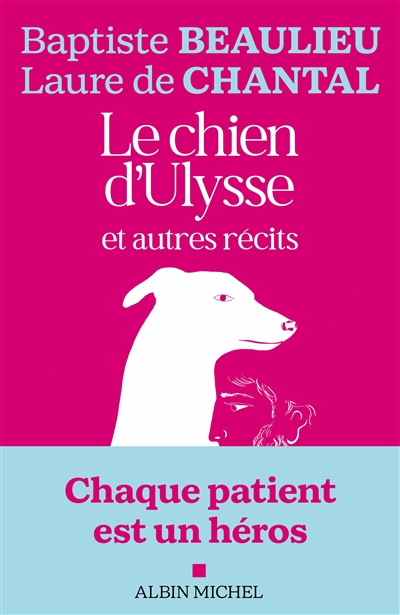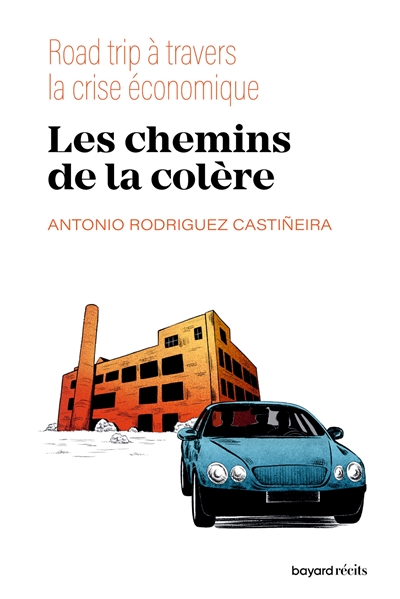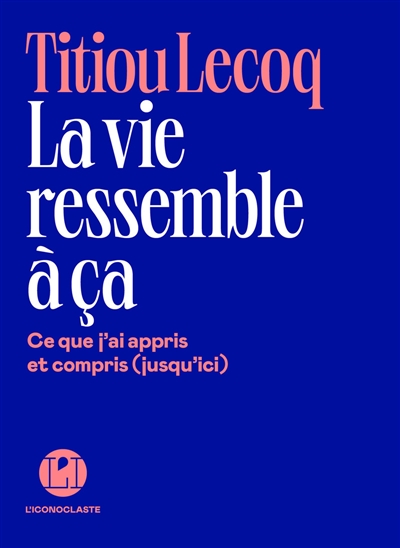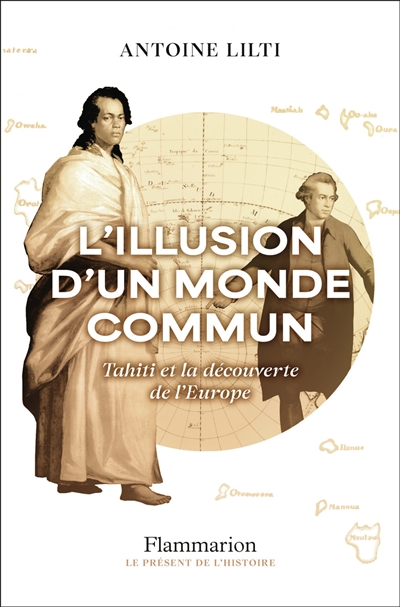Pourquoi un simple vêtement est-il devenu un symbole pour les pro et les anti-uniformes ?
Jean-Claude Kaufmann – Le débat qui s’est installé en France est étonnamment dogmatique et éloigné des faits. Il s’enferme dans une sorte de réalité parallèle, un discours répétitif dominé par l’idéologie, opposant les pour et les contre. La droite et l’extrême-droite se sont emparées de l’uniforme scolaire, devenu symbole d’une restauration de l’ordre et de la discipline. La gauche s’est dès lors mobilisée contre parce qu’il était de droite, un symbole réactionnaire. Or la vérité n’est ni dans un camp ni dans l’autre, ni même au milieu : elle est ailleurs. Si l’uniforme scolaire se développe depuis une vingtaine d’années à travers le monde, c’est pour des raisons que l’on ne retrouve guère dans le débat actuel en France.
Pourquoi et où se sont imposés les premiers uniformes scolaires ?
J.-C. K. – L’origine la plus marquante se situe au XVIe siècle en Angleterre quand un projet de scolarisation des plus pauvres invente les premières tenues communes non religieuses, sobres mais empreintes de fierté. Ce modèle social, en se mélangeant subtilement à des formes plus élitistes (cravate et blazer), déboucha sur un style vestimentaire définissant le rôle d’écolier et qui allait se diffuser sur les trois-quarts de la planète. Pendant ce temps-là, en France, cela ne s’est pas du tout passé de la même manière et nous sommes encore aujourd’hui les héritiers de cette Histoire française très politique et très polémique. C’est d’abord la gauche radicale, contre la droite conservatrice attachée à la liberté des familles, qui lance l’idée de l’uniforme, notamment dans le plan d’éducation nationale défendu par Robespierre à la Convention. Napoléon reprend l’idée mais en la détournant, dans une perspective impériale de conquêtes : l’uniforme scolaire prend alors une dimension militariste, ce qui va mobiliser l’opposition de la gauche. Les camps se sont inversés.
Vos recherches vous ont emmené à regarder les pratiques tout autour du globe. En quoi ces exemples enrichissent-ils notre débat ?
J.-C. K. – C’est crucial. Il est impératif de regarder ce qui se passe en dehors de nos frontières pour sortir de notre repli nombriliste et de nos idées toutes faites. D’autant que c’est nous (la France de l’Hexagone et l’Europe continentale) qui sommes une exception. Pourquoi ce sont les démocrates qui relancent l’uniforme scolaire aux États-Unis ? Pourquoi des ONG l’affichent-elles comme une priorité dans leur combat contre la pauvreté en Afrique ? Pourquoi l’uniforme se développe-t-il dans les DROM-TOM sans la moindre consigne de l’administration ? Dans notre période troublée, déstabilisée par un mouvement d’émancipation individuelle mal contrôlé, l’uniforme scolaire pourrait offrir des suggestions intéressantes. Au moins serait-il judicieux d’ouvrir le débat sur ce point. La question est de savoir si l’enfant à l’école est uniquement un sujet absolu, libre d’exprimer tous ses désirs ou s’il est aussi dans un rôle particulier, celui d’écolier. Ce qui ne signifie pas ordre et discipline.
Vous vous êtes penché sur les cas récents d’expérimentations. Quels biais impliquent de telles études ?
J.-C. K. – J’ai répertorié près de 200 études à travers le monde dont je fais la synthèse. Beaucoup en effet ont des biais qui faussent un peu les résultats. Mais ces biais n’empêchent pas d’en faire une analyse critique et d’en tirer beaucoup d’enseignements. Rien ne serait pire que d’ignorer les nombreuses études qui ont été faites. Et qui nous apprennent par exemple comment l’uniforme change l’état d’esprit, l’« ambiance », le « climat » dans une école.
Une fois encore, votre méthode spécifique, la microsociologie montre son efficience. En quoi consiste-t-elle justement ?
J.-C. K. – Pour mener mes enquêtes, je pars de choses toutes simples, de moments de la vie quotidienne, d’objets ordinaires. Mon défi est de les faire parler pour raconter le monde d’aujourd’hui, de dévoiler par leur intermédiaire et de façon concrète comment fonctionne notre société. Et l’uniforme scolaire a vraiment beaucoup à nous dire : il n’a rien d’anodin et n’est pas un archaïsme. Il s’inscrit pleinement dans les questions du temps présent.
Les arguments autour de l’uniforme scolaire s’appuient souvent sur des clichés. Pour démontrer leurs faiblesses, le sociologue Jean-Claude Kaufmann en décortique l’histoire et les enjeux, d’une façon toujours malicieuse. Il observe où et pourquoi l’uniforme est porté de par le monde et la manière dont les chercheurs sont sollicités pour apporter des arguments scientifiques en sa faveur. Le livre fait le tour de la question, tout en gardant la distance nécessaire et un regard sociologique : il nous permet de mieux appréhender les raisons fondamentales pour lesquelles ce questionnement mérite toute notre attention. Un ouvrage complet manquait pour poser les bases indispensables au débat et revenir à l’expérimentation d’une tenue scolaire.