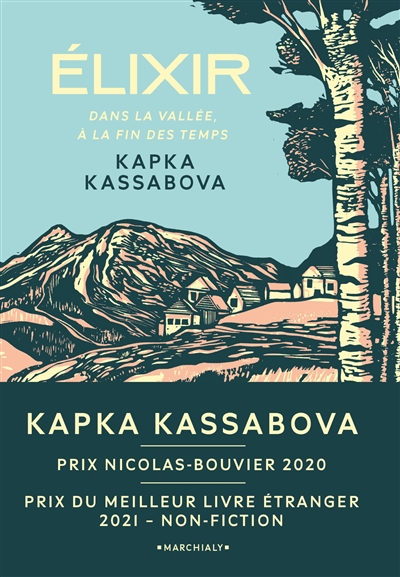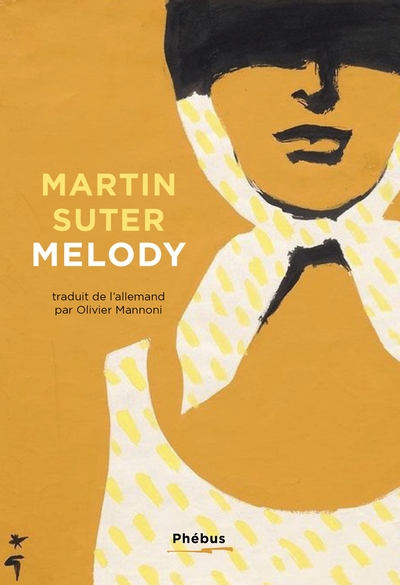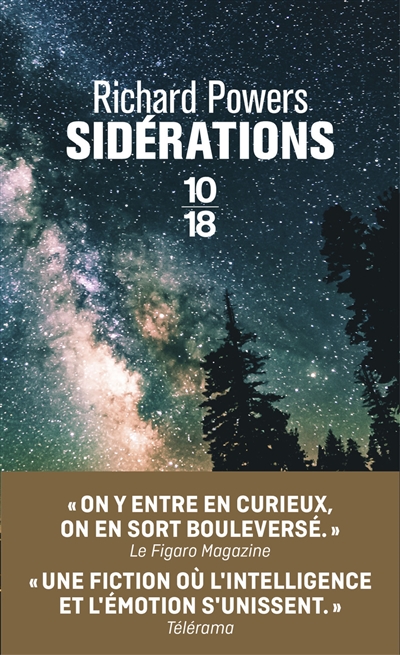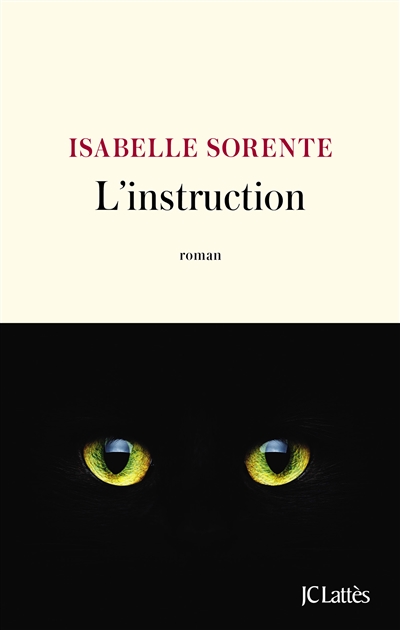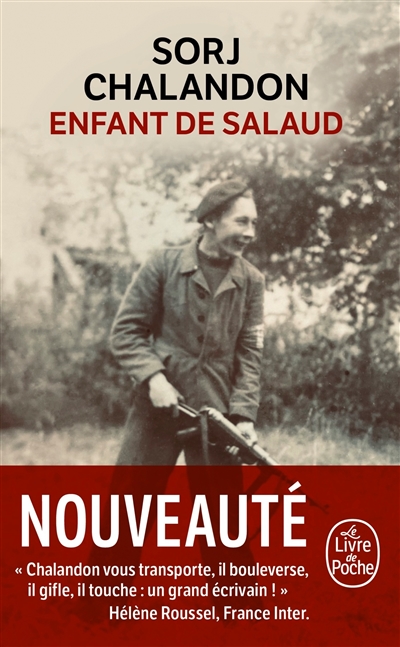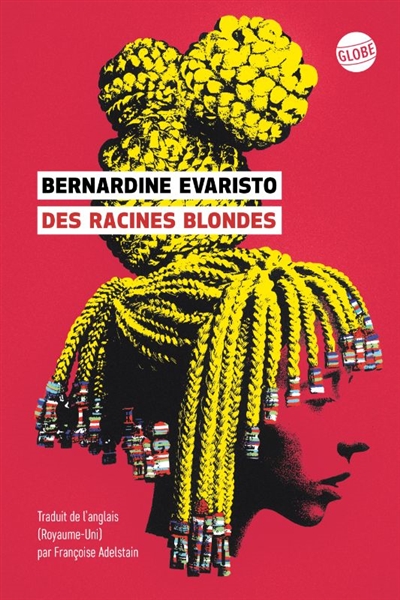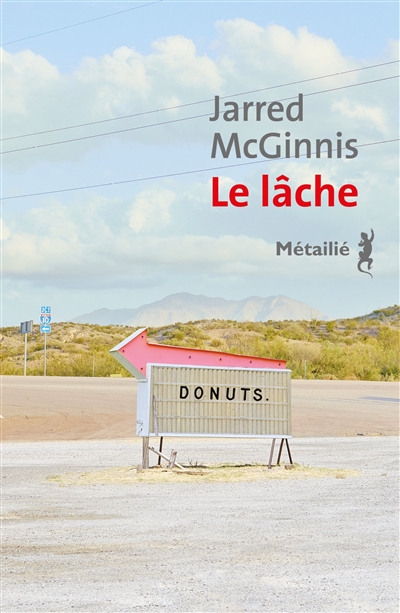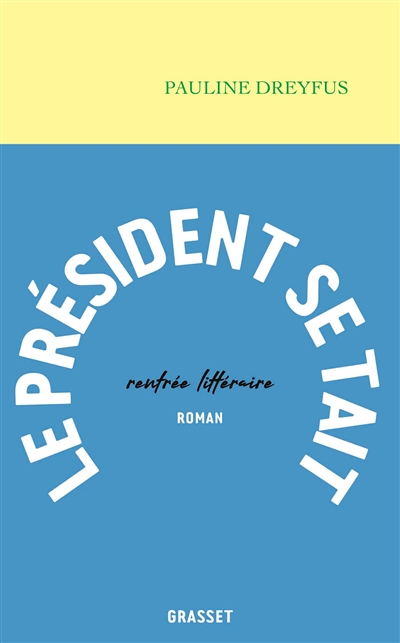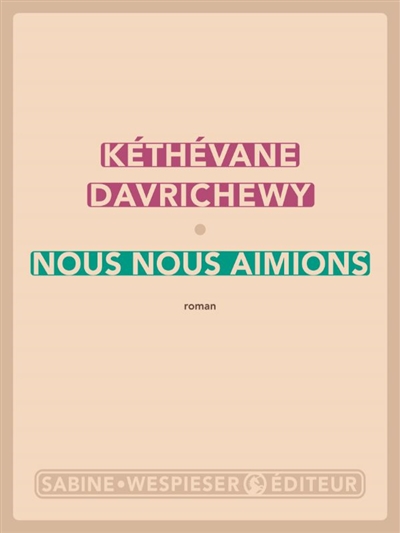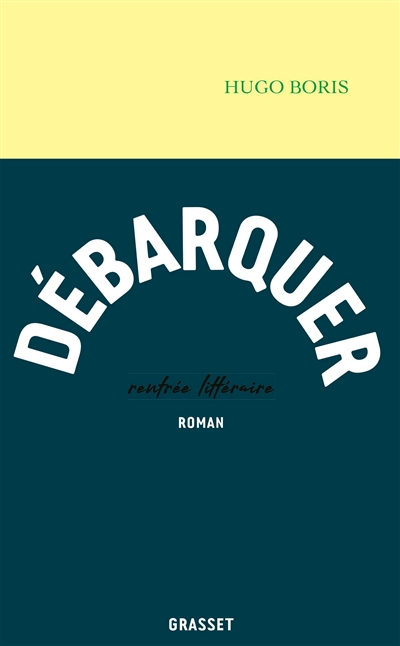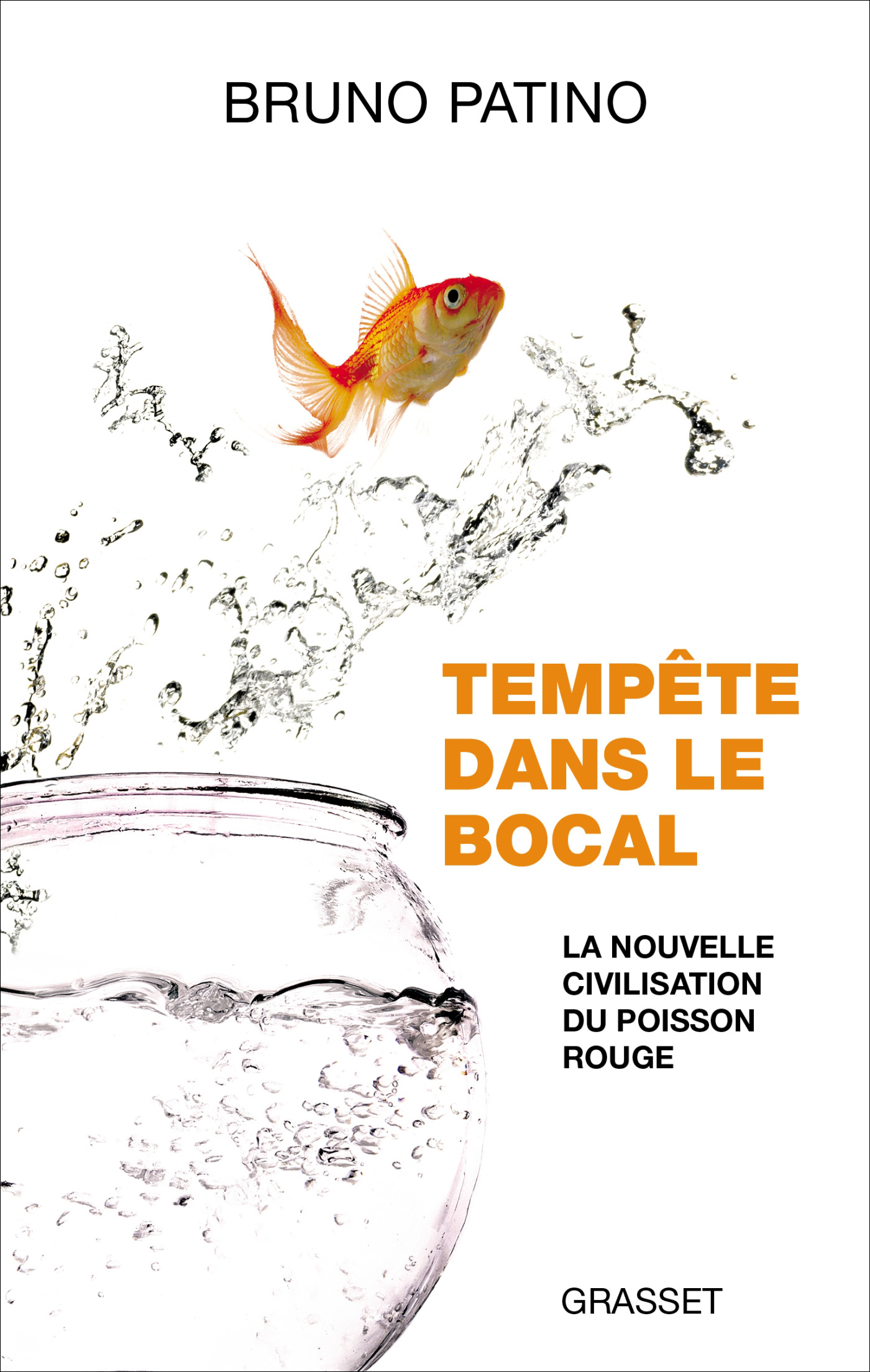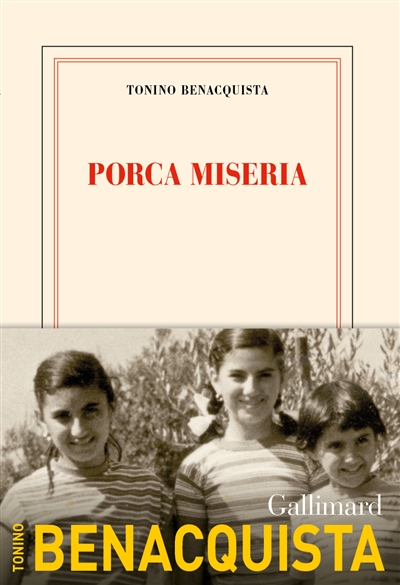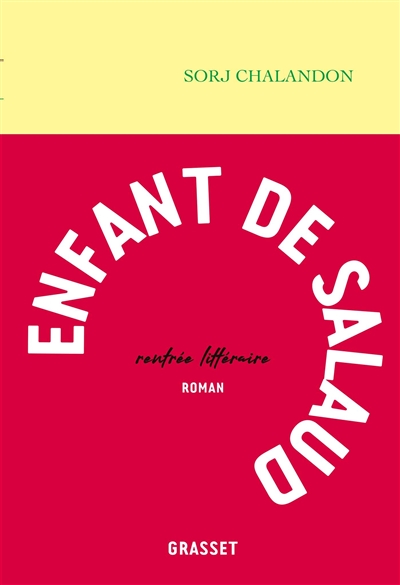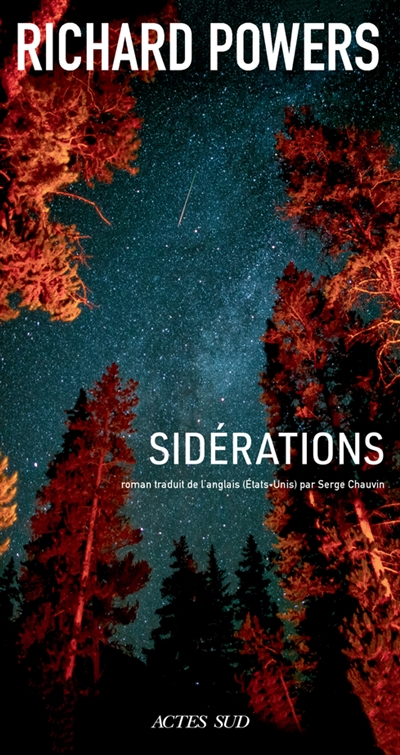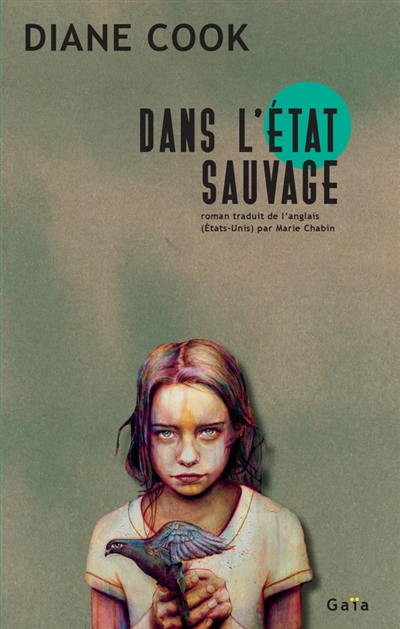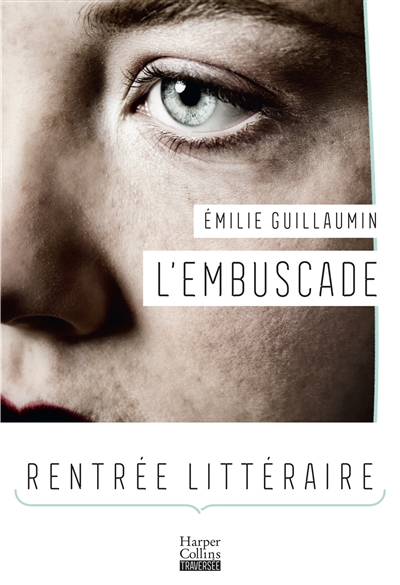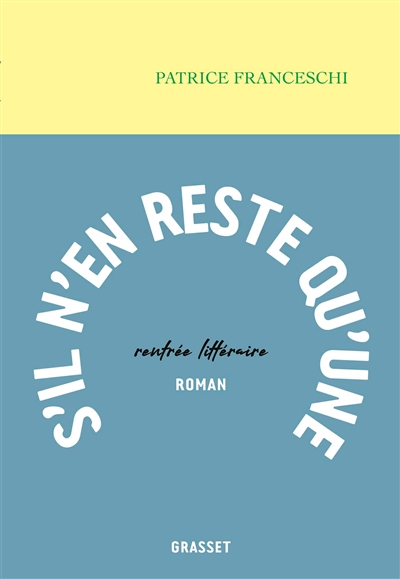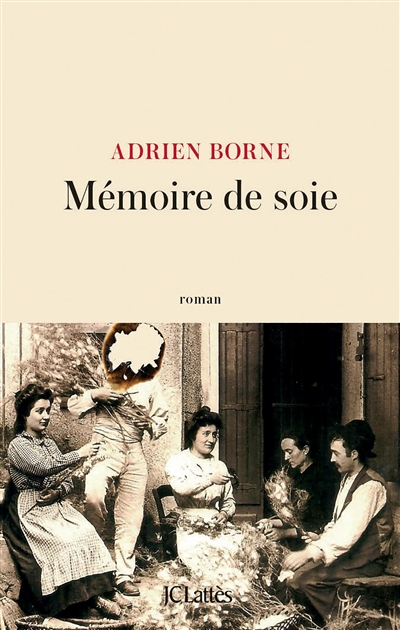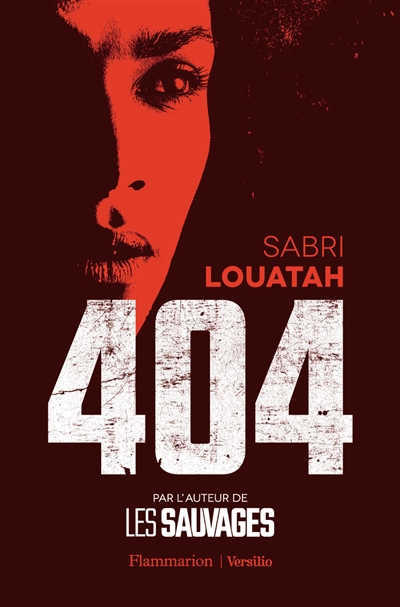Littérature française
Philippe Jaenada
La Serpe
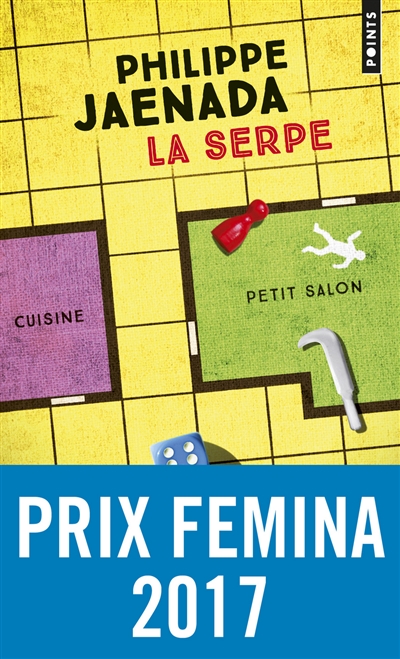
-
Philippe Jaenada
Points
04/10/2018
696 p., 8.90 €
-
Chronique de
Élodie Bonnafoux
Librairie Arcanes (Châteauroux) -
Lu & conseillé par
30 libraire(s)


Chronique de Élodie Bonnafoux
Librairie Arcanes (Châteauroux)
Avec cet énorme roman-univers de plus de 600 pages, prix Femina 2017, Philippe Jaenada nous entraîne dans l’incroyable tourbillon que fut la vie d’Henri Girard qui, avant d’écrire Le Salaire de la peur sous le pseudonyme de Georges Arnaud, fut accusé d’avoir massacré son père, sa tante et leur bonne à coup de serpe.
Henri Girard était le genre de mauvais garçon qu'on adore détester : fils de bonne famille, prodigue et irrévérencieux, il dilapidait allègrement la fortune familiale à Paris, entretenu par un père et une tante fort généreux. Sa vie bascule en 1941, alors qu'il a 24 ans, avec ce terrible massacre perpétré dans le château familial, du côté de Périgueux. Tout l'accuse. Principal suspect donc, confronté à la police puis à la justice de Vichy, il va passer deux années en préventive dans des conditions épouvantables avant d'être acquitté grâce à l'intervention providentielle de Maurice Garçon, célèbre avocat et grand ami de son père. C'est cela qui a mis la puce à l'oreille de Philippe Jaenada : pourquoi ce seigneur du barreau parisien aurait-il défendu Henri Girard becs et ongles s'il le croyait coupable du meurtre de son ami ? L'enquête et le traitement judiciaire n'auraient-ils pas été honnêtes ? Aurait-on brisé la vie d'un homme pour rien ? Nous voilà plongés dans les affres de cette affaire, pour laquelle finalement personne n'a jamais été condamné.
PAGE — La Serpe parle de vies détruites par la folie ou par l’injustice. Pourtant la tendresse et l’humour y sont omniprésents. C’est aussi une question d’équilibre romanesque ?
Philippe Jaenada — Bien sûr. C’est pour une raison technique, littéraire : mon but est naturellement d’installer le lecteur dans l’histoire, de l’envelopper. J’essaie donc de ne pas lui donner que du sombre, du lourd, du pénible, mais aussi des petits moments de distraction, d’amusement, de plaisir facile. Et aussi pour une raison plus profonde, plus humaine : j’aimerais que mes livres soient (modestement) une sorte de reflet de la vie, du monde, un calque réduit, approximatif. Or la vie, le monde (attention, scoop !), ce n’est pas toujours un gros bloc noir et pesant, ni d’ailleurs un poulain qui gambade dans un champ de pâquerettes. C’est un mélange des deux (j’avais prévenu).
P. — Au-delà du temps qui vous sépare, vous semblez avoir développé un lien particulier avec Henri Girard. Auriez-vous pu écrire ce livre si cet homme, malgré son histoire hors normes, n’avait été qu’un pâle salaud ?
P. J. — Non, je ne crois pas. Pour écrire, j’ai besoin, comme le lecteur j’espère, de m’engloutir dans mon livre. Et pour m’engloutir dans mon livre, j’ai besoin de faire corps avec les personnages (puisque eux sont incrustés dans mon livre) – au moins avec le personnage principal, les autres, je peux me contenter de les regarder, de les décrire. Or je n’ai pas tellement envie de faire corps avec un pâle salaud, merci bien.
P. — La Serpe est un roman à tiroirs fait de digressions, de flash-back, d’allers-retours entre les années 1940 et aujourd’hui, entre votre histoire et celle d’Henri Girard. Pourtant on ne s’y perd jamais. Comment en avez-vous imaginé la construction ?
P. J. — La construction, le système de narration, c’était à la fois le plus intéressant et le plus difficile. Le sujet, je l’avais : il m’est tombé du ciel, un très bon sujet, une bonne histoire et je n’y suis absolument pour rien, tout ça s’est passé sans moi. Mon rôle, c’était d’en faire un livre, de le raconter correctement, de transformer les faits en un objet, une œuvre (grand mot, mais qu’est-ce que je peux dire ?), qui soient assimilables, utilement, profondément, par les lecteurs. (Dans la marge de l’un des ouvrages dont je me servais pour la documentation, j’ai écrit, au moment de la préparation : « Si je n’arrive pas à faire un bon livre avec ça, plus la peine d’insister, je deviens banquier ou boulanger. ») Ce n’était pas évident, j’ai beaucoup réfléchi, il ne fallait pas que je me trompe, que je gâche la matière première. Finalement, j’ai opté pour quelque chose d’assez simple : je voulais qu’en lisant, on suive le même chemin que moi quand j’ai entendu parler du triple meurtre et découvert peu à peu la vie d’Henri Girard. (Pendant des semaines, des mois, je l’ai pris pour un pâle salaud, pour un assassin cynique. Et puis je suis allé consulter les archives à Périgueux, et tout à coup, quoique pas à pas, mon regard a changé.) Quand, après avoir réuni, trié, classé toute la documentation, j’ai choisi cette construction, j’ai commencé à écrire. Je savais que les digressions, les sauts de côté, les anecdotes personnelles, viendraient s’insérer dans le texte, au fil de l’écriture, de manière presque automatique, naturelle en tout cas, et que l’ensemble donnerait peut-être quelque chose de pas mal.
P. — Les nombreuses allusions à vos précédents romans sont aussi une manière d’intégrer La Serpe à une œuvre plus vaste ?
P. J. — On peut peut-être dire ça comme ça, oui. Mais ce n’est pas volontaire, calculé. Il me paraît normal d’évoquer, dans un roman, le précédent. Autant je voudrais que le maximum de vie soit dans mes romans, autant les romans que j’écris, évidemment, sont dans ma vie, en font partie – une bonne partie, même. Quand j’en ai terminé un, je ne l’oublie pas, et la personne dont j’ai raconté l’histoire encore moins. Je pense toujours à Bruno Sulak, Pauline Dubuisson ou Henri Girard, ils font maintenant partie de moi, leur souvenir du moins, donc il est naturel que je revienne régulièrement à eux. Si ça permet de créer des liens entre mes romans, de les réunir comme des perles (fantaisie) qui forment un collier, tant mieux. Rien ne me fait plus plaisir que lorsqu’on me dit : « Je vous ai découvert il y a six mois avec La Serpe (ou La Petite Femelle, ou Sulak) et j’ai lu les autres ensuite. » Ça me donne l’impression d’avoir écrit un gros livre plutôt que dix petits. (Bon, « petits », je me comprends.) Et ça me paraît une bonne chose de passer sa vie à écrire un gros livre.